Dernière modification de l’article le 20 septembre 2025 par Admin
Depuis des années, on critique les notes.
Elles démotiveraient.
Elles créeraient de l’anxiété.
Elles réduiraient un enfant à un chiffre, comme si sa valeur se résumait à un 9/20 griffonné en haut d’une copie.
Mais ce ne sont que des discours.
La vraie question, c’est : que se passe-t-il quand une école décide réellement de supprimer les notes à l’école?
Quand plus aucun bulletin ne sanctionne.
Quand l’évaluation se résume à des feedbacks, des échanges, des observations.
Quand les élèves ne sont plus comparés par un chiffre, mais accompagnés dans leur progression.
Est-ce que les jeunes retrouvent le plaisir d’apprendre, libérés de la peur du jugement ?
Est-ce qu’ils deviennent plus autonomes, plus curieux, plus confiants ?
Ou bien est-ce que l’absence de repères les déstabilise, les prive de cadre, et finit par créer un nouveau stress ?
Ces expériences existent. Elles ont été menées, parfois depuis des années dans le cadre de la psychologie et de l’éducation.
Et leurs résultats sont bien plus surprenants qu’on ne l’imagine.
Parce qu’une école sans notes n’est pas forcément une école plus juste.
Tout dépend de ce qu’on met à la place.
Article et texte écrits par Jean-François MICHEL Auteur « Les 7 profils d’apprentissage » Éditions Eyrolles 2005, 2013, 2019 et 2024 
Les expériences nordiques : quand l’école choisit de retarder la note
En Norvège, la loi interdit les notes chiffrées avant la classe de 8 ce qui correspond au début du collège, en 5ᵉ dans le système français.
Concrètement, de la CP jusqu’à la 6ᵉ, les élèves ne reçoivent aucun chiffre sur leurs copies.
Leur évaluation repose uniquement sur des retours oraux ou écrits.
Pendant toute l’école primaire et le début du collège, les élèves reçoivent uniquement des retours écrits ou oraux.
Les chercheurs observent un phénomène troublant [1]: quand les notes à l’école sont introduites dès la classe de 7 en Norvège — c’est-à-dire l’équivalent de la 6ᵉ en France — la motivation et le ressenti scolaire chutent. La transition vers le collège (5ᵉ) devient plus douloureuse et la performance académique s’en trouve fragilisée.
En Suède [2], même logique : les notes à l’école ne commencent qu’à 13 ans. Avant, les enfants passent des évaluations formatives, mais sans chiffre.
L’idée est simple : laisser les élèves apprendre avant de juger.
En Finlande, les élèves ne reçoivent pas de notes chiffrées avant la 4ᵉ année du cycle élémentaire (environ entre 10 et 11 ans). Jusqu’à ce moment, l’évaluation repose sur le feedback verbal ou écrit, des entretiens, et une appréciation qualitative.
À partir de la 4ᵉ année, des bulletins numériques apparaissent, avec une notation sur une échelle de 4 à 10. Pendant toute l’école de base (jusqu’à la 3ᵉ finlandaise), il n’y a aucun examen national standardisé : les enseignants suivent les élèves via une évaluation formative locale, régulière et individualisée.
Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture (défini par l’Éducation nationale finlandaise), entré en vigueur en 2016 pour les années primaires, encourage explicitement ces pratiques évaluatives variées et guidantes, plutôt qu’un recours systématique à la notation chiffrée.
Le résultat ? Une culture éducative où la progression personnelle prime sur la comparaison sociale.
Quel bilan ?
Si on se réfère au dernier classement PISA de 2022 [3], les résultats et le classement sont plutôt contrastés.
Les élèves des écoles nordiques ont perdu le classement de tête, pour sombrer dans un milieu de tableau. A peine mieux que la France finalement, voire pire pour la Norvège.
Regardons cela de plus près !
La Finlande, souvent citée comme modèle, se situe à la 12ᵉ place mondiale. Une position correcte, mais loin du sommet. Derrière les discours élogieux, la réalité est plus sobre : le recul des notes a apporté du bien-être scolaire… sans pour autant garantir une performance académique exceptionnelle.
La Suède, à la 19ᵉ place, tient une position honorable, mais pas éclatante. On lui reconnaît une école équilibrée, moins anxiogène. Mais là encore, difficile de parler de succès flamboyant quand d’autres pays, restés fidèles à une notation exigeante, trônent dans le top 10.
La France, en 26ᵉ position, fait à peine mieux que survivre. Elle n’est pas en queue de peloton, mais elle n’est pas non plus une locomotive. Ses débats sans fin sur l’évaluation masquent un problème plus profond : l’absence d’accompagnement réel, le manque de suivi personnalisé, une pédagogie qui peine à se réinventer.
Et puis la Norvège, classée 32ᵉ, sous la moyenne de l’OCDE. Elle illustre un paradoxe criant : repousser les notes à l’école peut soulager les élèves… mais sans un travail pédagogique solide derrière, la performance académique s’érode.
En somme, ces classements disent une chose simple et dérangeante : l’excellence scolaire ne naît pas de l’absence de notes.
Elle naît de la qualité de l’écosystème éducatif. De la formation des enseignants. De la taille des classes. Du temps consacré au feedback. Des moyens investis.
Les notes ne sont qu’un symptôme. Le cœur du problème, c’est ce qu’on met — ou qu’on ne met pas — à leur place. »
Bref, elles révèlent une manière de penser l’école : sanctionner ou accompagner, comparer ou faire progresser.
Du feedback régulier ou du silence.
De la confiance ou du soupçon.
De l’accompagnement individualisé ou de la gestion de masse.
Supprimer la note ne résout rien par magie.
C’est le système derrière qui fait toute la différence.
Un système où l’élève comprend son chemin, où l’enseignant a le temps de suivre, où l’évaluation devient une boussole plutôt qu’un couperet.
Psychologie et éducation : les autres expériences d’écoles sans note
1. Les écoles démocratiques : la liberté comme boussole
Pas de notes à l’école.
Pas de tests.
Pas de classe imposée.
À Summerhill, à Sudbury Valley, dans les écoles libres de Brooklyn ou d’Albany, l’élève n’est pas un numéro dans une salle.
C’est un citoyen en devenir.
On lui fait confiance.
On lui donne les clés de son apprentissage.
Résultat ? Une estime de soi qui ne s’écroule pas au premier échec.
Une autonomie qu’aucune note rouge n’a jamais su construire.
Une capacité à se diriger dans la vie adulte, parce qu’on a appris tôt à prendre des décisions pour soi.
Et quand ces jeunes arrivent à l’université, surprise : ils réussissent. Pas moins bien que les autres. Souvent même mieux. Plus créatifs. Plus confiants. Plus capables de travailler en équipe.
Mais ne nous trompons pas : ce modèle n’est pas magique. Il demande un cadre invisible, mais puissant. Des familles qui soutiennent, des enseignants qui accompagnent, une communauté qui croit en la curiosité naturelle de l’enfant.
Sans ça ? La liberté se transforme en errance. L’autonomie promise devient désorientation. Et l’école sans notes se réduit à une coquille vide.
2. L’Allemagne : quand la note recule pour laisser place aux mots
Dans certaines écoles primaires allemandes, on a osé supprimer les notes chiffrées.
À la place, les enfants reçoivent des appréciations verbales.
Des phrases. Des mots. Des descriptions.
On ne dit pas : « 8/20 en lecture ».
On écrit : « Ton aisance de lecture progresse, tu prends confiance à voix haute, continue à t’entraîner sur la fluidité ».
C’est une autre logique.
On ne réduit pas l’enfant à une moyenne. On lui tend un miroir où il peut lire ses forces et ses marges de progression.
Et les résultats ?
Pas de chute brutale en maths.
Pas d’effondrement en lecture.
Les enfants apprennent autant. Mais ils apprennent autrement.
Avec moins d’angoisse. Avec plus de coopération entre eux.
Le climat de classe s’apaise, les tensions baissent.
Sur le papier, c’est idéal.
Mais quand les notes reviennent plus tard — au collège — la transition est rude.
Les élèves qui n’ont jamais été jugés par un chiffre découvrent soudain l’arbitraire des moyennes et le couperet des classements.
Et pour certains, c’est un choc.
Voilà la limite.
Supprimer la note à un moment de la scolarité ne suffit pas.
Il faut penser la suite.
Préparer la rencontre inévitable avec le chiffre.
Sinon, l’élève risque de vivre la notation non comme un outil, mais comme une gifle.
La leçon ?
L’expérience allemande montre qu’un bulletin peut être un texte au lieu d’une grille.
Que les mots rassurent mieux que les chiffres.
Mais elle nous rappelle aussi que l’école n’est pas une bulle fermée.
Un jour ou l’autre, les notes reviennent. Et c’est là que tout se joue : dans la manière dont on prépare l’élève à les affronter.
3. Les États-Unis : quand l’université dit stop aux notes
Outre-Atlantique, certaines universités ont décidé d’en finir avec les notes chiffrées.
Pas de A, pas de B, pas de C.
Bienvenue dans le mouvement Ungrading.
Le principe ?
Plus de moyennes, plus de points.
À la place : de l’auto-évaluation, des entretiens réguliers, des feedbacks narratifs.
L’étudiant n’est plus un réceptacle à notes, mais un acteur qui réfléchit à son propre apprentissage.
Et les résultats ?
Moins de stress, plus d’engagement en classe.
Des étudiants qui osent davantage, qui prennent des risques intellectuels, qui écrivent avec créativité au lieu de chercher la formule qui leur rapportera un 15/20.
Mais il y a un revers : privés de notes, certains étudiants perdent leurs repères.
Ils se demandent : « Suis-je dans la moyenne ? Est-ce que je vaux quelque chose ? »
La note, même injuste, donne un cadre. Son absence totale peut plonger certains dans l’incertitude.
C’est le paradoxe de l’Ungrading.
Supprimer la note ne suffit pas à libérer.
Il faut installer une culture du feedback, riche, régulière, exigeante.
Sans ça, l’expérience tourne au brouillard.
Là encore, la leçon est claire :
Ce qui transforme l’étudiant, ce n’est pas l’absence de chiffres.
C’est la qualité du dialogue pédagogique qui vient les remplacer.
Une note en moins sans feedback solide, c’est comme enlever les panneaux de signalisation sur une route… sans donner de carte.
4. Le Canada : remplacer les chiffres par des mots-clés
Au Québec comme en Colombie-Britannique, des écoles ont osé ranger les notes chiffrées au placard.
Pas de 12/20. Pas de 65 %.
À la place : des mentions comme « acquis », « en développement », « en émergence ».
Sur le papier, c’est plus doux.
L’enfant n’est pas comparé à un barème figé, il est situé dans un chemin d’apprentissage.
Ça change le regard des enseignants, ça change le climat des classes, et ça change aussi le dialogue avec les familles.
Plutôt qu’un chiffre qui inquiète, un mot qui explique.
Les enseignants apprécient, les élèves respirent, la relation avec les parents s’apaise.
Mais tout n’est pas si simple.
De nombreux parents restent attachés aux notes.
Pour eux, un « acquis » ne vaut pas un 16/20 : le mot rassure moins que le chiffre.
Il manque la précision, l’évidence d’un indicateur lisible.
Résultat ? Les tensions ne disparaissent pas, elles se déplacent.
Moins d’angoisse pour l’enfant certes, mais plus de doutes pour les parents.
Avec un paradoxe bien réel : on enlève le chiffre pour libérer l’élève, mais on crée de l’insécurité chez les adultes.
La leçon ?
Changer l’évaluation, ce n’est pas seulement transformer les bulletins.
C’est aussi transformer les mentalités.
Tant que les parents continueront à demander « combien il a eu ? », les mots remplaceront mal les chiffres.
5. L’Italie : apprendre sans notes, mais avec exigence
Dans les écoles Montessori, comme dans celles inspirées de Reggio Emilia, les notes n’existent pas.
Pas de carnet rempli de chiffres.
Pas de rang dans la classe.
À la place ?
Des observations minutieuses, des portfolios détaillés, des échanges réguliers avec les familles.
On suit l’enfant comme un chercheur suit une expérience.
On observe, on note les progrès, on ajuste.
Chaque élève avance à son rythme, mais pas au hasard.
Et les résultats ?
Les études sont claires : les enfants Montessori réussissent aussi bien, parfois mieux, en lecture et en mathématiques que leurs camarades d’écoles classiques.
Mais surtout, ils développent une chose rare : autonomie, créativité, compétences sociales.
Ils savent coopérer, inventer, chercher des solutions originales.
C’est ça, le paradoxe italien : l’absence de notes ne rime pas avec laxisme.
Derrière l’apparente liberté, il y a une rigueur immense.
Un cadre précis, pensé pour stimuler l’élève et non pour le juger.
Le secret n’est pas dans la suppression des notes.
Il est dans ce qu’on met à la place : une pédagogie cohérente, exigeante, fondée sur la confiance et l’observation.
Sans ça, enlever les notes n’est qu’un slogan.
Avec ça, c’est une révolution silencieuse.
Quels enseignements ?
Les expériences se multiplient : les écoles démocratiques misent sur la liberté, l’Allemagne préfère les mots aux chiffres, les universités américaines testent l’ungrading, le Canada transforme les bulletins en mentions, et l’Italie, avec Montessori et Reggio Emilia.
Ces différentes expériences démontrent qu’il est possible de réussir sans notes, à condition de bâtir un cadre exigeant et cohérent.
Et puis il y a les pays nordiques.
La Finlande, la Suède, la Norvège ont repoussé ou supprimé les notes à certains niveaux, avec la promesse d’un climat scolaire plus serein, d’élèves moins stressés et d’une motivation accrue.
Mais lorsque l’on regarde les résultats PISA 2022, l’illusion se fissure :
la Finlande n’est plus la star qu’elle était et n’occupe plus que la 12ᵉ place mondiale ;
la Suède se maintient en 19ᵉ position ;
la France n’est pas loin derrière à la 26ᵉ ;
la Norvège chute encore davantage à la 32ᵉ place.
En résumé : pas de podium, pas de miracle, simplement la réalité crue des chiffres.
Alors, qu’apprendre de tout cela ?
Que supprimer les notes n’est ni une baguette magique, ni une catastrophe, mais une option pédagogique qui ne vaut que par ce qu’on installe à la place.
Là où l’on met du feedback régulier, du temps pour accompagner chaque élève, une culture éducative cohérente et un écosystème complet, la suppression des notes peut être un levier puissant.
Mais là où l’on retire simplement le chiffre sans rien proposer de solide derrière, on ne fait que créer du vide.
Pour les enseignants, formateurs français et francophones
Et pour nous, enseignants français, la leçon est limpide.
Le vrai enjeu n’est pas de se perdre dans le débat stérile « pour ou contre les notes ».
Il est de réfléchir à ce que nous faisons de l’évaluation, chaque jour, dans nos classes.
Allons-nous continuer à réduire un élève à un chiffre qui rassure les parents mais qui ne dit rien de sa progression réelle ?
Ou allons-nous transformer ce moment d’évaluation en un outil puissant, capable de guider, d’éclairer, de motiver ?
Car l’excellence ne naît pas du 15/20 griffonné en haut d’une copie.
Elle naît du feedback qui donne envie de se dépasser, de l’explication précise qui aide à comprendre une erreur, du regard de l’enseignant qui transmet à l’élève une conviction simple : « tu peux y arriver ».
Alors, comment faire ?
Voici quelques pistes concrètes :
Allonger le feedback au-delà du chiffre : un « 12/20 » n’explique rien.
Ajoutez une phrase, même courte : « Bien structuré, mais attention à la rigueur des exemples », « Tu as de bonnes idées, mais la formulation reste trop floue ». Ces mots orientent l’élève, là où le chiffre l’enferme.
Mettre en avant la progression plutôt que la sanction : valorisez les progrès, même petits.
Un élève qui passe de 6 à 8 n’a pas « raté à nouveau », il a progressé.
Montrez-lui qu’il avance, car c’est cette conscience du mouvement qui nourrit la motivation.
Pratiquer l’auto-évaluation : demandez à l’élève de relire son travail et d’identifier ce qu’il a bien réussi et ce qu’il doit améliorer.
Cela l’oblige à réfléchir sur son propre apprentissage, plutôt que d’attendre passivement un verdict.
Varier les formes de retour : tout n’a pas besoin d’être écrit.
Un mot glissé à l’oral, un échange rapide en fin de cours, une remarque positive devant le groupe peuvent avoir plus d’impact qu’une ligne rouge sur une copie.
Construire un langage commun avec les parents : expliquez que le chiffre ne suffit pas, que l’évaluation doit montrer une trajectoire.
Les rassurer ne passe pas uniquement par un bulletin, mais par une explication claire de la progression de leur enfant.
Vous avez vu : ces différentes pratiques ne demandent pas de révolution du système, seulement une révolution du regard.
Car l’évaluation n’est pas une fin en soi.
C’est un levier.
Elle peut être couperet ou tremplin, sanction ou moteur.
Et au fond, tout se joue là : dans la manière dont nous, enseignants, choisissons chaque jour de brandir un chiffre… ou d’ouvrir un chemin.
Lire l’article sur « Est-il nécessaire de supprimer les notes à l’école ? »
Sources et références
[1] Études sur l’introduction précoce des notes (Norvège)
Gro Marte Strand (NTNU) – Étude qualitative sur le passage au collège
- Une recherche menée à partir de trois sous-études qualitatives, portant sur un groupe de 165 élèves suivis de la fin de la classe de 7 jusqu’à la classe de 10, a montré que l’introduction de notes dès la classe de 7 (équivalent de la 6ᵉ en France) peut nuire à la transition vers le collège et fragiliser la motivation et les résultats scolaires : https://norwegianscitechnews.com/2023/05/grades-shouldnt-be-introduced-too-early
Hampus Liljeröd et al. (2025) – Perceptions des élèves du secondaire
- Une étude auprès de 35 élèves de l’enseignement secondaire dans un contexte nordique (Norvège et Suède), menée via des entretiens semi-structurés, montre que les notes peuvent à la fois activer ou désactiver la motivation des élèves, en fonction de leur perception des notes (positives ou négatives). Elles influencent leurs émotions, leur image de soi académique, ainsi que la manière dont ils investissent leur temps et leur effort – https://www.researchgate.net/publication/392762971_Students%27_perceptions_of_how_grades_influence_their_motivation_voices_of_upper_secondary_school_students_in_Norway_and_Sweden
[2] Études sur l’évolution de l’évaluation en classe (11–13 ans)
- G. Olovsson (2015) a observé deux années consécutives dans des classes de 5ᵉ (11–12 ans) puis de 6ᵉ (12–13 ans), avant et après l’introduction des notes de fin de trimestre et des tests nationaux. Il conclut à une transformation notable des pratiques : davantage de communication sur les objectifs d’apprentissage, une attention accrue à la compréhension des élèves, et une plus grande formalisation des attentes – https://pdf.sciencedirectassets.com/277811/1-s2.0-S1877042815X00292/1-s2.0-S1877042815027986/main.pdf?X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjEGYaCXVzLWVhc3QtMSJHMEUCIBj%2FY6qB6WPtertNWMYGQnvLnwdCny%2BxaY%2Fch80%2Fp4P%2BAiEA%2BBPIqRjnXS3OaMYKKZ5AcWUSRIpZfyTCz
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2%253A888440/FULLTEXT01.pdf
Une recherche récente (2022) dans la région de Scania montre que, conformément à la curriculum national (Skolverket, 2018), l’évaluation formative est largement utilisée en classe élémentaire (de la classe préparatoire à la 3ᵉ année). Ce type d’évaluation favorise une meilleure compréhension du niveau des élèves (où ils en sont) et guide leur progression, même si la mise en œuvre reste parfois limitée par des contraintes de temps ou de ressources – https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2%253A1659999/FULLTEXT02
[3] Résultat globaux PISA 2022 https://worldpopulationreview.com/country-rankings/pisa-scores-by-country
[4] Écoles démocratiques (sans notes/tests, autogestion) https://www.summerhillschool.co.uk
https://www.brooklynfreeschool.org
[5] Allemagne – écoles primaires avec appréciations verbaleshttps://www.schulgesetz-berlin.de/berlin/grundschulverordnung/teil-v-lernerfolgsbeurteilung-und-qualitaetssicherung/sect-19-grundsaetze-der-leistungsbeurteilung.php
[6] États-Unis – mouvement « Ungrading »https://www.hampshire.edu/academics/how-you-study/narrative-evaluations-portrait-you
https://wvupressonline.com/ungrading
[7] Canada – Colombie-Britannique : échelle de maîtrise/proficiency K-9 (sans lettres/chiffres) https://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/k-12/administration/legislation-policy/public-schools/student-reporting
[8] Italie – pédagogies sans notes (Montessori / Reggio Emilia) – https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10406168/
https://www.montessori-science.org/Science_Evaluating_Montessori_Education_Lillard_.pdf
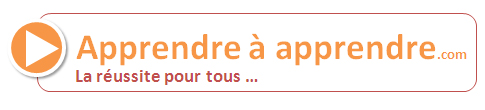

Première prise de connaissance
Merci pour votre message