Dernière modification de l’article le 2 octobre 2025 par Admin
Combien de fois avez-vous eu l’impression de passer plus de temps à éteindre des feux qu’à enseigner ?
Un élève qui s’emporte, deux qui se provoquent.
Une remarque qui met tout le groupe à cran.
Et vous, coincé(e) au milieu.
Comme un arbitre qui n’a pas demandé à siffler un match, mais qui se retrouve au centre d’un ring improvisé.
Le problème, ce n’est pas le conflit.
Le conflit est normal : partout où il y a des humains, il y a des tensions.
Le vrai problème dans l’enseignement, c’est ce que devient le conflit quand il n’est pas géré.
Un mot de travers se transforme en rancune.
Une étincelle se propage et enflamme toute la classe.
Un incident isolé devient une habitude, une atmosphère.
Et petit à petit, le climat s’alourdit, les élèves apprennent moins.
Vous vous épuisez davantage.
Et la salle de classe, censée être un lieu d’apprentissage, devient un champ de bataille où personne ne sort gagnant.
Alors, comment faire pour que le conflit cesse d’être une menace ?
Comment transformer cette énergie brute en occasion d’apprendre… autrement ?
Article et texte écrits par Jean-François MICHEL Auteur « Les 7 profils d’apprentissage » Éditions Eyrolles 2005, 2013, 2019 et 2024 
Pourquoi les conflits explosent si facilement ? Les 3 phénomènes psychologiques
✳️ 1. Le biais de négativité : le « poison qui touche plus fort que le miel »
Les recherches en psychologie sociale montrent que les événements négatifs frappent plus fort que les positifs. Roy Baumeister et ses collègues ont popularisé cette idée dans l’article [1]“Bad Is Stronger Than Good” (2001) : « le mauvais est plus fort que le bon » — c’est-à-dire qu’un événement négatif produit des effets psychologiques plus intenses et durables qu’un événement positif de même intensité.
Concrètement, cela signifie qu’une remarque blessante — une moquerie, une phrase sarcastique — laisse une empreinte émotionnelle bien plus profonde que de simples compliments.
Dans une classe ou un groupe de formation, une parole maladroite ne « tombe pas dans l’oubli » : elle s’accroche, se rumine, génère de la rancœur.
Un article de 2008 publié dans la revue « Pyschological Bulletin » [2] explore cette asymétrie : les adultes tendent à prêter plus attention, retenir davantage et réagir plus fortement à l’information négative par rapport à l’information positive.
Une insulte, une remarque blessante sont comme une tache d’huile dans l’eau claire des échanges bienveillants : elle attire le regard, se propage, et obscurcit tout le paysage relationnel.
✳️ 2. L’effet miroir émotionnel : quand la colère se propage comme un virus surtout dans un contexte d’enseignement
Les émotions ne restent pas confinées chez celui qui les ressent. Selon Elaine Hatfield, John Cacioppo et Richard Rapson (Emotional Contagion, 1994) [3], nous avons tendance à mimer automatiquement les expressions, les gestes, le ton de ceux qui nous entourent. Ce mimétisme déclenche un feedback interne qui modifie notre propre émotion.
Autrement dit, vous voyez un élève froncer les sourcils, hausser la voix, serrer les poings ? Sans y penser consciemment, vous adaptez micro-gestes, posture, intonation. Vous « attrapez » cette émotion. La classe entière vibre à l’unisson — souvent vers le haut, parfois vers le bas.
L’article “Emotional Contagion” retrace les mécanismes :
- Mimétisme (expressions, posture, voix)
- Feedback somatique (nos propres micro-réactions renforcent l’émotion)
- Convergence émotionnelle : les individus finissent par ressentir ce que les autres ressentent.
Revenons dans un contexte d’enseignement. Imaginez maintenant votre salle de classe.
Un élève s’agace, tape du pied, hausse le ton.
Sans le vouloir, d’autres adoptent la même crispation, la tension grimpe.
Bientôt, la classe entière vibre à l’unisson, non pas vers la concentration, mais vers la colère.
Dans un contexte de salle de classe ou de formation, un élève frustré, colérique ou agité peut contaminer tout le groupe en quelques instants.
C’est comme une bonbonne de gaz qui fuit lentement dans une pièce.
Au début, personne ne voit rien… mais on commence à sentir quelque chose dans l’air.
Une atmosphère lourde, chargée, que chacun perçoit sans toujours mettre de mots dessus.
Puis l’étincelle arrive — un mot de travers, un regard de défi, une injustice perçue — et l’explosion se déclenche.
Pas seulement pour l’élève concerné. Toute la classe est secouée.
Cette tension invisible mais perceptible, c’est exactement l’atmosphère qui précède le conflit : tout le monde la respire, tout le monde l’absorbe, et il suffit d’un rien pour que l’équilibre bascule.
Alors la colère se propage comme une traînée de poudre. La bonne nouvelle, c’est que la joie et l’enthousiasme se transmettent tout aussi vite.
Selon Hatfield et ses collègues, la contagion émotionnelle est un phénomène neutre : elle peut jouer en faveur du chaos ou de l’harmonie. Tout dépend de la première étincelle.
Un enseignant qui entre en classe avec une énergie posée et confiante impose naturellement un climat différent.
Un sourire sincère, une voix calme, une posture ouverte… et déjà les élèves copient inconsciemment.
Leur respiration ralentit, leur ton baisse, leur attention se recentre.
De nombreuses recherches sur l’effet Pygmalion (Rosenthal & Jacobson, 1968) [4] ont d’ailleurs montré que les attentes et l’attitude d’un enseignant influencent directement la performance des élèves.
Pourquoi ? Parce que les émotions transmises par l’adulte façonnent la perception que l’élève a de lui-même… et donc son comportement.
Imaginez une classe comme un diapason. Si l’enseignant frappe la première note sur une tonalité de calme et de bienveillance, toute la salle vibre sur cette même fréquence.
Concrètement, cela veut dire quoi ?
- Commencer le cours avec une respiration consciente, un sourire, un mot positif.
- Nommer les réussites avant les erreurs.
- Montrer par son attitude qu’on croit à la capacité de chacun d’y arriver.
En diffusant des émotions stables et constructives, l’enseignant devient l’accordeur invisible de l’atmosphère de sa classe.
✳️ 3. La réactance psychologique : quand l’autorité provoque la résistance
La théorie de la réactance psychologique, initialement formulée par Jack Brehm (1966) [5], décrit un mécanisme puissant : quand une personne perçoit qu’on lui restreint sa liberté (de pensée, de parole, d’action), elle ressent une poussée motivationnelle pour restaurer cette liberté.
Dans “Understanding Psychological Reactance” (Steindl et al., 2015) [6] , on voit que cette réaction se manifeste sous forme d’hostilité, de contre-arguments, de refus — parfois même contre ce qui était initialement proposé.
Voici le principe de réactance psychologique appliqué à un contexte d’enseignement ou de formation :
- Si un enseignant impose une règle d’autorité sans explication, certains élèves se sentent « opprimés » : leur liberté d’agir ou de penser est menacée.
- Une consigne formulée comme « Il faut faire ceci, point final » déclenche souvent une contre-réaction, même chez des élèves bien disposés.
- Plus l’autorité cherche à s’imposer par la force (menace, pression, contrôle écrasant), plus la résistance intérieure peut s’amplifier.
✳️ En résumé
- Un mot blessant pèse cinq fois plus — la négativité a un pouvoir d’impact disproportionné.
- Les émotions voyagent aussi vite qu’un souffle — un seul individu peut contaminer toute la classe.
- L’autorité imposée suscite la rébellion intérieure — le contrôle excessif génère de la résistance.
C’est la conjonction explosive de ces trois phénomènes qui transforme une tension banale en conflit destructeur, presque sans prévenir.
La gestion des conflits, ce n’est pas de courir avec un extincteur quand tout a déjà explosé.
C’est d’installer un détecteur de gaz pour capter la tension avant qu’elle ne devienne toxique.
C’est de prévoir une soupape de sécurité pour relâcher la pression, doucement, sans casse.
Et c’est de montrer aux élèves que cette énergie brute peut être utilisée autrement : non pas pour détruire la classe, mais pour la renforcer.
Le coût réel des conflits mal ou non gérés dans l’enseignement
Un conflit mal géré, ce n’est pas un simple incident à oublier.
C’est une facture invisible que l’on paie tous les jours. Et la voici détaillée en 3 points TVA incluses !
⏳ 1. Perte de temps
Chaque dispute avale de précieuses minutes.
Un échange qui dérape, une altercation qu’il faut calmer.
Et voilà dix minutes de cours envolées.
Dix minutes, multipliées par le nombre de semaines, par le nombre de classes…
À la fin de l’année, ce sont des heures entières d’enseignement sacrifiées.
Du temps qui aurait pu être consacré à l’apprentissage, mais qui se dissout dans la gestion des tensions.
C’est comme remplir un seau percé : peu importe vos efforts, une partie de votre énergie s’écoule dans le vide.
✳️ 2. Épuisement émotionnel
Vivre dans une classe où les conflits surgissent régulièrement, c’est comme marcher sur un champ de mines.
On ne sait jamais où, ni quand, ça va exploser.
Résultat : l’enseignant vit en hypervigilance permanente. Toujours sur le qui-vive, toujours prêt à intervenir.
Cette tension chronique use les nerfs, vide les batteries, et ouvre la voie au burn-out.
Les recherches en psychologie du travail montrent que l’exposition répétée aux conflits est un facteur majeur d’épuisement professionnel. [7]
Quand le cerveau est constamment mobilisé pour gérer l’imprévu et la tension sociale, il consomme une énergie énorme.
À la longue, le corps et l’esprit s’effondrent.
✳️ 3. Apprentissage et enseignement perturbés
Et les élèves dans tout ça ?
Eux aussi paient le prix.
Car une salle de classe tendue n’est pas un lieu d’apprentissage.
On sait maintenant que le stress aigu mobilise l’énergie du cerveau pour gérer la menace… au détriment de la mémoire et de l’attention [8].
Autrement dit, quand l’atmosphère est chargée de tension, l’élève ne peut pas apprendre.
Il n’écoute plus, il se protège.
Il ne réfléchit pas, il se replie.
Le conflit devient un bruit de fond permanent qui brouille toute tentative de transmission.
C’est comme essayer d’enseigner dans une pièce où l’alarme incendie hurle en continu. Même la meilleure explication devient inaudible.
En somme, chaque conflit mal ou non géré n’est pas un accident isolé.
C’est un poison lent.
Il vole du temps, épuise l’enseignant, paralyse l’apprentissage.
Les solutions : comment transformer le conflit en ressource pédagogique ?
1. Nommer les émotions au lieu de les nier
Le premier réflexe face à un élève en colère ou en pleurs, c’est souvent de dire :
« Calme-toi. »
« Ce n’est rien. »
« Arrête de faire une histoire. »
En réalité, c’est la pire chose à faire.
Pourquoi ? Parce que nier une émotion, c’est comme essayer de repousser un ballon gonflé sous l’eau : plus vous appuyez, plus il remonte violemment à la surface.
Daniel Goleman, dans ses travaux sur l’intelligence émotionnelle, l’a montré : mettre des mots sur une émotion réduit son intensité.
C’est ce qu’on appelle parfois l’étiquetage émotionnel.
Quand un élève s’entend dire par son enseignant :
– « Je vois que tu es en colère. »
– « Tu sembles déçu. »
– « J’ai l’impression que tu es inquiet. »
Il se sent reconnu. Il comprend que ce qu’il vit est légitime, qu’il n’est pas seul à le porter. Cette simple reconnaissance agit comme une soupape : la pression baisse.
Des études en neurosciences confirment ce mécanisme [9]. Matthew Lieberman [10] a montré que nommer une émotion active le cortex préfrontal et réduit l’activité de l’amygdale, centre de la peur et de la colère.
Autrement dit, poser des mots apaise le cerveau émotionnel et rétablit le contrôle.
C’est comme allumer la lumière dans une pièce sombre. Tant que l’émotion reste dans l’ombre, elle fait peur, elle déborde. Dès qu’elle est nommée, elle devient visible, gérable.
En classe, il ne s’agit pas de jouer les psychologues, mais simplement de reconnaître ce qui est là.
Car une émotion niée devient un incendie.
Une émotion reconnue devient une braise qui s’éteint d’elle-même.
2. Sortir du triangle dramatique de Karpman
Quand un conflit éclate, il est très tentant de vouloir « régler » vite la situation.
Et sans s’en rendre compte, l’enseignant se retrouve piégé dans ce que Stephen Karpman a appelé le triangle dramatique : trois rôles qui se répondent et s’entretiennent mutuellement.
- La Victime : « On m’a fait du mal, je subis. »
- Le Persécuteur : « C’est de ta faute, tu es le problème. »
- Le Sauveur : « Ne t’inquiète pas, je vais te défendre. »
À première vue, ces rôles semblent naturels. On croit remettre de l’ordre. Mais en réalité, ils alimentent le conflit.
Prenons un exemple concret dans une situation d’enseignement :
Deux élèves se disputent.
Si l’enseignant désigne un coupable (« Tu as tort, c’est toi qui as commencé »), il endosse le rôle de juge… donc de Persécuteur.
Si au contraire il protège l’un des deux (« Mon pauvre chéri, c’est injuste ce qu’il t’arrive »), il devient Sauveur… et enferme l’autre dans le rôle de Victime.
Résultat : personne n’apprend à se responsabiliser.
Le conflit ne se résout pas, il se répète.
Comment en sortir ?
La clé, c’est de quitter le triangle, de ne plus jouer l’un de ces rôles.
Il s’agit de redevenir observateur neutre.
Décrire les faits, sans juger.
Nommer ce qui se passe, sans chercher à désigner un bon ou un mauvais.
Puis inviter chacun à prendre sa part de responsabilité.
Exemple :
« Vous êtes en train de vous couper la parole. L’un se sent attaqué, l’autre se sent ignoré. Qu’est-ce que chacun peut faire maintenant pour avancer ? »
C’est un changement radical : l’enseignant n’est plus arbitre, ni pompier, ni protecteur.
Il devient facilitateur.
Il ouvre un espace où chacun peut reconnaître sa part et chercher une solution.
C’est comme un jeu de cordes emmêlées.
Tant que l’enseignant tire lui-même sur un des fils (Victime, Persécuteur, Sauveur), le nœud se resserre.
Quand il arrête de tirer et invite les élèves à démêler ensemble, les tensions se relâchent et le conflit se défait.
En sortant du triangle dramatique, l’enseignant ne perd pas son autorité.
Au contraire, il gagne en légitimité.
Car il ne se place pas au-dessus ou à la place des élèves : il leur rend leur pouvoir d’agir.
3. La règle des 90 secondes (Jill Bolte Taylor)
Une émotion paraît parfois interminable.
On a l’impression qu’un élève en colère va exploser pendant des heures.
Mais la science raconte une autre histoire.
La neuroscientifique Jill Bolte Taylor [11] explique qu’une émotion intense, déclenchée par une réaction chimique dans le cerveau, dure physiologiquement environ 90 secondes.
Au-delà, si elle persiste, c’est parce que nous la ravivons par nos pensées : on rumine, on se répète le scénario, on relance le feu.
Autrement dit : la vague émotionnelle est courte. Ce qui la prolonge, c’est l’essence qu’on y verse.
En pratique, cela change tout pour l’enseignant.
Lorsqu’un élève est pris par une émotion forte, inutile d’intervenir immédiatement pour « régler » la situation par la force ou par les mots.
Mieux vaut laisser la vague passer.
Comment ?
– Respirer lentement, montrer par son attitude que l’on garde son calme.
– Instaurer quelques secondes de silence.
– Donner à l’élève un court espace pour que la réaction chimique s’épuise.
Au bout d’une minute et demie, le niveau de tension baisse déjà. C’est le moment où l’élève est plus réceptif, plus capable d’entendre, plus disponible pour reprendre le dialogue.
C’est comme une tempête soudaine sur la mer.
Inutile de ramer à contre-courant en plein ouragan.
Il suffit d’attendre que la rafale passe pour retrouver une eau navigable.
Cette règle simple transforme la gestion des conflits :
Moins de paroles dites trop vite, moins de décisions prises sous le coup de la colère.
Et surtout, une classe où l’on apprend à respecter les rythmes naturels du cerveau.
4. Utiliser la métacommunication
Quand un conflit éclate, nous sommes souvent happés par le contenu :
« Il a triché. »
« Elle ne m’écoute pas. »
« Ce n’est pas juste. »
Le danger ? Rester prisonnier du sujet de surface.
Et plus on tente de résoudre ce contenu immédiat, plus on s’enlise.
La métacommunication consiste à changer de niveau.
C’est dire : « Stop. On ne parle plus du problème en lui-même. On parle de notre manière de communiquer autour de ce problème. »
Exemple simple :
Deux élèves se coupent sans cesse la parole.
Au lieu d’intervenir sur le fond (« Qui a raison, qui a tort ? »), l’enseignant dit :
« Là, on n’est plus en train de discuter du problème de maths ! Mais plutôt de se couper la parole et de s’énerver. Parlons d’abord de ça. »
Instantanément, la tension baisse.
Parce qu’on vient de sortir du ring.
On a cessé de boxer, pour analyser ensemble les règles du combat.
Pourquoi ça marche ?
- Cela crée une prise de recul immédiate. Le conflit n’est plus « toi contre moi », il devient « nous contre le problème de communication ».
- Cela active le cortex préfrontal, la zone du cerveau liée à l’analyse et au raisonnement, au lieu de rester coincé dans le système limbique (colère, frustration).
- Cela redonne du pouvoir aux participants, qui se sentent acteurs de la résolution plutôt que spectateurs d’une sanction.
C’est comme une pièce de théâtre.
Au lieu de continuer à jouer un rôle dans la dispute, on se tourne vers le public et on dit : « Regardez ce qui se passe entre nous. »
Ce décalage brise l’illusion et offre une nouvelle perspective.
Concrètement, la métacommunication peut s’exprimer par de petites phrases-clés :
- « Là, on ne parle plus du fond, mais de la façon dont on se parle. »
- « Je remarque qu’on s’interrompt beaucoup. Comment faire pour s’écouter davantage ? »
- « J’ai l’impression que le ton monte. Avant de continuer, voyons comment chacun peut s’exprimer calmement. »
La gestion des conflits ne veut pas dire éviter les conflits
Beaucoup d’enseignants rêvent d’une classe sans conflits.
Un lieu où chacun s’écoute, où les tensions n’existent pas, où tout est fluide et apaisé.
Mais ce rêve est trompeur, comme de croire au père Noël. Car, nous avons affaire à de l’humain. Et plus il y a d’humains, imaginez vos 30, 35 élèves dans une classe, plus la probabilité de conflit devient est forte.
Je dirais même que les conflits sont inévitables dès qu’il y a de la vie, des émotions, des différences.
Ils surgissent parce que les élèves ont des personnalités, des besoins et des visions du monde qui ne s’accordent pas toujours.
Vouloir supprimer totalement les conflits reviendrait à supprimer ce qui fait l’humanité même de la classe.
Bref, la gestion des conflits ne veut pas dire éviter les conflits.
Le vrai enjeu n’est pas de les fuir, ni de les étouffer.
Il est d’apprendre à les traverser, à les transformer.
Un conflit mal géré agit comme un incendie de forêt : il dévore tout sur son passage.
Il détruit la confiance, installe la peur, fige l’apprentissage.
Mais ce même conflit, bien géré, devient une ressource.
Comme un feu qu’on canalise dans une cheminée : il réchauffe, éclaire et rassemble.
Dans cette perspective, chaque tension devient une opportunité.
Une opportunité pour l’élève d’apprendre à exprimer ce qu’il ressent sans blesser.
Un moment privilégié pour le groupe d’expérimenter l’écoute, le respect, la réparation.
Une chance pour l’enseignant de montrer que l’autorité, ce n’est pas écraser, mais accompagner vers la responsabilité.
C’est pourquoi le conflit n’est pas un échec de la classe.
Gérer un conflit, ce n’est pas l’éteindre coûte que coûte.
Ce n’est pas l’éviter, ni le craindre.
C’est apprendre à transformer l’énergie brute des flammes en chaleur utile.
C’est utiliser l’incendie pour chauffer la maison, et non pour la réduire en cendres.
Et c’est là le paradoxe le plus puissant : un conflit bien géré ne divise pas.
Il unit sans fragiliser la classe, la rend plus forte face aux tempêtes à venir.
Sources et références
[1] « Bad Is Stronger Than Good » par Baumeister, Bratslavsky, Finkenauer & Vohs – Review of General Psychology (2001) – https://assets.csom.umn.edu/assets/71516.pdf
[2] « Not all emotions are created equal: The negativity bias in social-emotional development » – https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3652533/
https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2F0033-2909.134.3.383
[3] Emotional Contagion de Hatfield, Cacioppo & Rapson (1993/1994) https://www.researchgate.net/publication/232480409_Primitive_emotional_contagion
[4] Effet Pygmalion (voir l’article du site)
[5] Psychological Reactance: An Introduction and Overview (Rosenberg & Siegel) — document récent reprenant les fondements de Brehm (1966) – https://www.researchgate.net/publication/392286092_Psychological_Reactance_Theory_An_Introduction_and_Overview
[6] Understanding Psychological Reactance: New Developments and Findings” (Steindl et al., 2015) – https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27453805/
[7] « The impact of interpersonal environment on burnout and organizational commitment » Michael P. Leiter, Christina Maslach October 1988 – https://doi.org/10.1002/job.4030090402
« Conflict Management Strategies as Moderators of Burnout in the Context of Emotional Labor » – https://doi.org/10.3390/soc15030063
[8] « Cognitive approaches to stress and coping » https://www.researchgate.net/publication/232207306_Cognitive_approaches_to_stress_and_coping
« The Coping Circumplex Model: An Integrative Model of the Structure of Coping With Stress » -Krzysztof Stanis April 2019 https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2019.00694/pdf
[9] « Subjective Responses to Emotional Stimuli During Labeling, Reappraisal, and Distraction » 2011 May 2;11(3):468–480. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3444304
[10] « Putting feelings into words: affect labeling disrupts amygdala activity in response to affective stimuli » — Lieberman et al. (2007) Psychological Science 18(5), 421-428 – https://sanlab.psych.ucla.edu/wp-content/uploads/sites/31/2015/05/Lieberman_AL-2007.pdf
[11] Jill Bolte Taylor elle-même évoque dans ses conférences, dans ses écrits (notamment My Stroke of Insight) l’idée qu’il y a une « cascade chimique » d’une émotion dont la phase physiologique dure environ 90 secondes : après cela, si l’émotion persiste, c’est parce qu’elle est ravivée par les pensées, les rumination, les interprétations. On retrouve cette idée dans des articles populaires ou des blogs (« When a person has a reaction … there’s a 90-second chemical process … after that … any remaining emotional response is just the person choosing to stay in that emotional loop »).
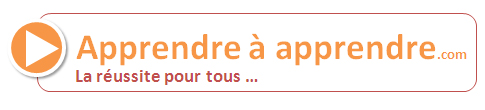

Bonne présentation du sujet. Idées très utiles à mettre en application pour transformer un conflit en situation d’apprentissage.
Bonjour,
Merci pour votre message et vos encouragements.
Bien cordialement
Jean-François