Dernière modification de l’article le 18 novembre 2025 par Admin
 Un élève clique.
Un élève clique.
En une fraction de seconde, ChatGPT lui rend un devoir sans faute, structuré, fluide.
Beaucoup s’alarment : l’IA va tuer l’éducation, anesthésier l’esprit critique, réduire les jeunes à des perroquets numériques.
Mais, entre nous, ce discours ne vous rappelle rien ?
Retour en l’an 2000. L’arrivée d’internet haut débit
Les mêmes prophéties catastrophiques : « Les jeunes ne liront plus », « Ils ne retiendront plus rien », « Le savoir est foutu ».
Et pourtant, plus de vingt ans plus tard, internet n’a pas détruit l’intelligence humaine.
Il l’a déplacée, amplifiée, transformée.
L’IA, c’est la même histoire.
Se battre contre elle, c’est comme vouloir interdire l’automobile en défendant les calèches.
On peut lever des pancartes, mais la route est déjà tracée.
Alors, que faire ?
Laisser l’IA écraser l’enseignement ? Ou l’utiliser comme un levier ?
On parle beaucoup de l’IA comme d’un super-pouvoir.
Mais derrière l’enthousiasme, certaines études posent une question dérangeante :
Et si ChatGPT nous rendait plus rapides… mais moins intelligents ?
Article et texte écrits par Jean-François MICHEL Auteur « Les 7 profils d’apprentissage » Éditions Eyrolles 2005, 2013, 2019 et 2024 
Quand le MIT mesure la paresse cognitive
En 2023, une étude menée par le MIT [1] a testé l’usage de ChatGPT pour rédiger des essais.
Résultat spectaculaire :
- Temps de rédaction réduit de 60 %.
- Mais effort mental pertinent réduit de 32 % (Noy & Zhang, 2023).
Autrement dit : l’IA écrit vite, mais en court-circuitant l’effort de réflexion.
Une économie de temps, oui. Mais une économie d’intelligence, aussi.
La mémoire qui s’évapore
La même étude montre un chiffre plus inquiétant encore :
83 % des participants étaient incapables de se souvenir d’un passage rédigé avec l’aide de ChatGPT.
On connaît déjà ce phénomène : c’est l’effet Google [2] (Sparrow, Liu & Wegner, 2011).
Quand on sait qu’une information est stockée sur internet, le cerveau choisit de ne pas la mémoriser.
Avec l’IA, on franchit une étape de plus : ce n’est pas seulement l’accès au savoir qui se déporte…
C’est le processus de pensée lui-même qui se délègue.
Quand la plasticité neuronale s’atrophie
Les neurosciences sont claires : le cerveau se renforce dans ce qu’il exerce, et s’affaiblit dans ce qu’il néglige.
Moins de concentration → moins de circuits neuronaux dédiés à l’attention.
Moins de mémoire sollicitée → mémoire qui s’appauvrit.
Moins de réflexion personnelle → perte progressive de la capacité à raisonner seul.
Comme un muscle, le cerveau se sculpte à l’usage.
Et une prothèse utilisée en permanence finit toujours par affaiblir le membre qu’elle remplace.
Le risque : uniformisation de la pensée
L’article pointe un autre danger : celui de l’uniformisation.
Quand tout le monde utilise la même IA, formée sur les mêmes corpus, les mêmes schémas, la diversité de la pensée s’aplatit.
On obtient des textes fluides, séduisants… mais prévisibles.
De la pensée « moyenne », servie sur plateau.
Le Biais de cadrage (framing effect) de cette étude.
Biais de cadrage : quand la question enferme déjà la réponse
Mais quand vous lisez ou entendait le mot « étude » attention.
J’ai été chercheur en économie. Et s’il y a bien une chose que j’ai pu constater c’est que les études ne sont jamais parfaites.
Elles éclairent un angle, mais laissent d’autres zones dans l’ombre.
Elles révèlent un aspect, mais en minimisent d’autres, parfois jusqu’à les ignorer.
Alors, quand vous entendez : « une étude affirme que… », méfiance.
Vous avez sûrement déjà lu ce genre de titre dans la presse : « une étude montre que le café réduit les maladies cardiovasculaires de X % ».
Fuyez !
Car derrière la statistique, il y a presque toujours un excès de simplification… qui finit par raconter quelque chose de faux.
Et dans cette étude du MIT n’y échappe pas : elle est victime d’un biais cognitif appelé biais de cadrage (ou framing effect en anglais).
Bref un grand classique quand des études ou des enquêtes sont réalisés.
Le biais de cadrage, ou framing effect, qu’est-ce que c’est ? C’est simple :
la manière dont on formule une question influence directement la réponse obtenue.
Exemple classique :
« Ce traitement sauve 90 % des patients » sonne rassurant.
« Ce traitement tue 10 % des patients » sonne effrayant.
Et pourtant… c’est la même réalité.
C’est exactement ce qui se passe avec l’étude du MIT.
Si vous définissez l’apprentissage comme la capacité à mémoriser du contenu produit, alors oui : l’IA appauvrit.
Vous déléguez la mémoire, et le cerveau retient moins. Forcément, le résultat est négatif.
Mais si vous définissez l’apprentissage comme la capacité à analyser, critiquer, restructurer un savoir, le résultat devient tout autre.
Parce que dans ce cadre-là, l’IA ne remplace pas la réflexion : elle la stimule, elle sert de brouillon, d’étincelle, de miroir.
Le biais de cadrage dans cette étude du MIT a choisi la première vision : la mémoire immédiate.
Donc la conclusion est déjà jouée d’avance.
C’est comme évaluer une calculatrice uniquement sur sa capacité à entraîner le calcul mental : vous ne verrez jamais le gain qu’elle apporte dans la résolution de problèmes plus complexes.
Voilà la puissance (et le danger) du biais de cadrage : il ne ment pas, mais il réduit la réalité à un angle étroit… et il vous fait croire que cet angle est toute la réalité.
Les 4 points de biais de recadrage de cette étude
- Apprentissage réduit à la mémoire
L’étude mesure la mémorisation immédiate et conclut que l’apprentissage est affaibli. Mais réfléchir, critiquer, structurer, ce n’est pas seulement « retenir ». Cet aspect est ignoré. - Effort cognitif réduit à la production brute
On mesure l’effort pour rédiger un essai, pas l’effort de formuler de meilleures questions, de vérifier, de corriger. Or, l’IA déplace l’effort cognitif, elle ne l’annule pas. - Accent mis sur la perte, pas sur le gain
On insiste sur la dépendance et la mémoire fragilisée, mais on passe sous silence les bénéfices : gain de temps, stimulation de la pensée critique quand l’IA est utilisée activement, possibilité d’aller plus loin. - Le mot “atrophie” oriente la lecture
Dès le titre, on installe l’idée d’une dégénérescence. Alors que ce qui se joue, ce n’est pas une atrophie, mais un déplacement de l’effort cognitif : moins de mémorisation brute, plus de stratégie et d’esprit critique — si l’on choisit de s’en servir ainsi.
Bref : comme toujours avec les études, tout dépend du cadrage.
Ce que le MIT a montré n’est pas faux, mais c’est partiel.
Et ce cadrage pousse à conclure trop vite que « l’IA affaiblit l’intelligence », alors qu’elle transforme surtout la nature de l’effort cognitif.
La vraie question n’est pas : « Perdons-nous notre intelligence ? »
Mais : « Vers quel type d’intelligence l’IA nous pousse-t-elle ? »
L’étude du MIT a, certes, fait grand bruit : avec ChatGPT, on écrit plus vite, mais on retient moins. La mémoire s’efface, l’effort cognitif chute. De quoi conclure que l’IA affaiblit l’intelligence.
Mais une méta-analyse toute récente, signée Wang et al. en 2025 [3], change radicalement la perspective. Elle compile 51 études menées depuis l’arrivée de ChatGPT. Et ce qu’elle montre, c’est que tout dépend du cadre.
Quand l’IA est utilisée comme béquille, oui, l’élève pense moins et délègue trop.
Mais quand elle est utilisée comme assistant, l’histoire est toute autre. Les performances s’améliorent.
La motivation augmente. La pensée de haut niveau, celle qui oblige à comparer, à analyser, à construire, est stimulée.
Le contraste est clair. L’IA ne condamne pas l’intelligence. Elle oblige à déplacer l’effort cognitif.
Moins de mémoire brute, plus de réflexion stratégique. Moins de stockage, plus de tri, de critique, d’interprétation.
En vérité, le danger n’est pas l’outil, mais la posture. Ceux qui s’en remettent aveuglément à l’IA deviendront ses esclaves. Ceux qui apprennent à l’utiliser comme un levier en feront un multiplicateur de puissance intellectuelle.
L’IA achève une illusion : l’école n’est plus le lieu du savoir
L’étude du MIT est claire : elle montre et accuse l’IA d’atrophier les capacités cognitives. On redoute qu’elle rende nos élèves paresseux, incapables de raisonner par eux-mêmes.
Mais ce discours masque une réalité plus profonde : ce n’est pas l’IA qui tue la réflexion. C’est le rapport au savoir qui a changé.
Mais souvenez-vous : avant les années 80, on valorisait la vitesse de calcul mental.
Puis la calculatrice s’est généralisée.
Devait-on interdire la calculatrice pour préserver nos cerveaux ?
Non. On a déplacé l’effort. L’enjeu n’était plus d’aligner des colonnes de chiffres, mais de savoir poser correctement un problème, comprendre quand et comment utiliser l’outil.
Aujourd’hui, nous vivons la même révolution avec l’IA.
Se focaliser à 100 % sur l’accumulation de savoirs, quand internet et l’IA rendent ce savoir accessible instantanément, c’est comme vouloir faire réciter des tables de multiplication à des ingénieurs de 2025 : un anachronisme.
La vérité est là : l’école n’est plus le lieu où l’on vient chercher du savoir.
Dès les années 2010, les élèves sortaient de classe et ouvraient Youtube pour chercher une explication plus claire, plus rapide, plus adaptée.
« Je n’ai rien compris au cours ? Pas grave. Youtube m’explique. »
Cette habitude a déjà déplacé le rapport au savoir. L’enseignant transmetteur était déjà fragilisé.
L’IA ne fait qu’achever une illusion : elle révèle, brutalement, que l’école ne peut plus se définir comme une bibliothèque humaine.
Alors, où est la valeur de l’enseignement ?
Dans l’accompagnement à la réflexion.
Dans l’art d’apprendre à apprendre.
Dans l’entraînement de l’esprit critique.
Dans la mise en relation, le débat, la création.
J’ai eu cette chance, dans les années 80, d’avoir des enseignants qui allaient au-delà de la simple transmission. Ils me forçaient à réfléchir. C’était rare à l’époque.
Aujourd’hui, ça devient vital.
Internet avait déjà fissuré le mythe.
L’IA en révèle l’effondrement.
Et si cela fait peur, c’est parce que beaucoup espéraient encore que l’école reste ce sanctuaire du savoir.
Mais non : l’école doit redevenir ce qu’elle aurait toujours dû être.
Non pas une salle d’archives, mais une forge.
Un lieu où l’on trempe les esprits au feu de la réflexion, où le savoir devient matière première et non finalité.
Je le répète : l’IA n’atrophie pas la cognition, elle change la nature de l’effort cognitif.
Autrement dit, la question n’est plus : « Que sait l’élève ? »
La question devient : « Que fait-il du savoir qu’il a entre les mains ? »
Et voici le véritable enjeu :
- Ceux qui apprennent à réfléchir feront de l’IA leur meilleur assistant. Ils seront capables de poser les bonnes questions, d’exploiter l’outil pour amplifier leur intelligence, d’aller plus loin et plus vite que jamais.
- Ceux qui n’auront pas fait cet effort — faute de pratique, de discipline ou de curiosité — deviendront esclaves de l’IA. Ils la suivront aveuglément, incapables de distinguer le vrai du faux, dépendants comme on l’est d’une béquille qu’on n’a jamais appris à poser.
Internet avait déjà fissuré le mythe.
L’IA en révèle l’effondrement.
Et si cela fait peur, c’est parce que beaucoup espéraient encore que l’école reste ce sanctuaire du savoir.
La clé est simple : ne pas la subir.
Une intelligence artificielle ne réfléchit pas. Elle répond.
Posez-lui une question idiote, elle vous rendra une idiotie polie.
Faites-lui une demande exigeante, elle deviendra un partenaire utile.
Concrètement, que peut faire un enseignant aujourd’hui ?
D’abord, arrêter de jouer la partie que l’IA gagne d’avance.
Orthographe parfaite, phrases bien tournées, mise en page impeccable… c’est son terrain. L’IA y sera toujours plus rapide, plus fluide, plus lisse qu’un élève.
Votre terrain à vous, c’est plus haut. Là où il faut analyser, critiquer, comparer, relier, créer.
Ensuite, changer le jeu.
Les dissertations recopiées à la maison ? C’est fini.
Un clic et elles sortent déjà prêtes.
Mais un débat en classe, une prise de parole, un projet collectif ?
Là, l’IA se tait. Parce qu’elle ne vit pas l’expérience, elle ne porte pas une pensée.
Troisième pas : transformer l’IA en complice.
Souvenez-vous de la calculette. On ne l’a pas interdite. On l’a mise au service de problèmes plus grands.
L’IA, c’est pareil. Elle peut résumer, suggérer, provoquer la contradiction.
Mais c’est à l’élève de trier, de comprendre, de trancher.
Enfin, redonner du sens.
Un devoir sans utilité réelle n’est qu’un prétexte à la note. Et là, l’IA devient une tentation irrésistible.
Mais si le travail sert une réflexion, une création, une mise en commun… alors l’IA n’est plus un raccourci. Elle devient un outil, un marchepied.
En vérité, l’IA ne menace pas l’éducation.
Elle oblige l’enseignement à redevenir ce qu’il aurait toujours dû être : un lieu où l’on apprend à penser, pas seulement à restituer.
Le choix est limpide :
être esclave d’une machine qui mâche les devoirs.
ou guider vos élèves pour qu’ils transforment l’IA en tremplin vers une réflexion plus profonde.
L’IA ne tue pas l’intelligence.
Elle met à nu la différence entre recopier… et comprendre.
Exemple d’activité : la chasse aux erreurs de l’IA
Étape n°1 – L’objectif pédagogique
- Développer l’esprit critique et la vigilance face aux sources d’information.
- Apprendre à vérifier, nuancer et compléter un contenu généré automatiquement.
- Dépasser la passivité de la copie pour entrer dans une démarche active d’analyse.
Étape n°2 – Préparer une consigne volontairement piégeuse
Exemples :
- « Explique-moi la Révolution française comme si j’avais 8 ans. »
- « Fais un résumé du poème Le Dormeur du val de Rimbaud. »
- « Rédige un commentaire sur les causes de la Première Guerre mondiale en 5 lignes. »
L’idée : obtenir un texte correct en apparence… mais qui contient forcément des lacunes, imprécisions ou simplifications abusives.
Étape n°3 – Lecture collective
Distribuer ou projeter la réponse générée par l’IA.
Première réaction des élèves : « C’est bien écrit, on pourrait rendre ça ! »
C’est justement là que l’exercice démarre.
Étape n°4 – Travail en groupes : la traque
Les élèves deviennent des « chasseurs d’erreurs ».
Chaque groupe doit :
- repérer une erreur factuelle, une approximation, un oubli ou un manque de nuance ;
- proposer une correction ou un ajout argumenté ;
- justifier pourquoi cette correction est nécessaire (sources, cours, réflexion).
Étape n°5 – Mise en commun et discussion
Chaque groupe présente ses « captures » (les erreurs repérées).
On discute collectivement : certaines erreurs sont réelles, d’autres sont discutables → parfait pour lancer un débat.
Étape n°6 – Conclusion de l’enseignant
Rappeler la règle d’or :
« Une IA ne pense pas. Elle compile. Elle peut bien écrire, mais mal raisonner. »
L’enseignant souligne que la compétence clé du XXIe siècle n’est pas de trouver une réponse, mais de savoir évaluer sa fiabilité.
Durée
- 1 heure environ (20 min préparation IA + 20 min chasse en groupe + 20 min mise en commun).
Variantes
- Version courte (15 min) : l’enseignant donne directement un texte d’IA avec 2-3 erreurs insérées volontairement. Les élèves les trouvent.
- Version avancée : comparer 2 réponses de ChatGPT sur la même question et demander : « Quelle est la plus pertinente ? Pourquoi ? »
- Version interdisciplinaire : l’IA traduit un texte en anglais/espagnol → les élèves corrigent.
Résultat : l’élève comprend que l’IA n’est pas un oracle, mais une matière brute à décoder. Il apprend à ne pas « avaler tout cru » une réponse bien rédigée, et à exercer son jugement — exactement la compétence que redoutent de perdre beaucoup d’enseignants.
Exemple dans différentes matières
Exemple avec les mathématiques – Les pourcentages
Consigne donnée à ChatGPT
« Un article coûte 80 €. Le magasin fait une réduction de 25 %, puis augmente ensuite le prix de 25 %. Quel est le prix final ? »
Réponse typique de l’IA
« On enlève 25 % de 80 €, soit 20 €, le prix passe à 60 €. Puis on ajoute 25 % de 60 €, soit 20 €. On revient donc à 80 €. Le prix final est 80 €. »
Erreur à chasser
❌ Faux raisonnement : une baisse de 25 % suivie d’une hausse de 25 % ne ramène jamais au prix de départ.
Correction :
- 80 € – 25 % = 60 €.
- 60 € + 25 % = 75 €.
✅ Le prix final est 75 €, pas 80 €.
Exemple avec l’histoire
Consigne donnée à ChatGPT
« Explique-moi les causes de la Première Guerre mondiale en 5 lignes. »
Réponse typique de l’IA
« La Première Guerre mondiale a commencé en 1914 à cause de l’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand d’Autriche. Cet événement a déclenché une réaction en chaîne entre les grandes puissances européennes. L’Allemagne voulait étendre son territoire et dominer l’Europe, tandis que la France cherchait à récupérer l’Alsace-Lorraine. Les rivalités coloniales et économiques ont accentué les tensions. La guerre a duré jusqu’en 1918 et a opposé les Alliés aux puissances centrales. »
Erreurs / imprécisions à chasser
- Simplification abusive :
Dire que « la guerre a commencé à cause de l’assassinat » est faux → ce n’est pas la cause unique, mais l’élément déclencheur.
Correction : parler d’un contexte de tensions déjà très fort. - Biais d’interprétation :
« L’Allemagne voulait dominer l’Europe » → formulation caricaturale.
Correction : évoquer la rivalité des alliances (Triple Entente vs Triple Alliance), la montée du militarisme. - Omission :
Pas un mot sur l’Empire austro-hongrois, la Russie et les Balkans, pourtant centraux dans l’origine du conflit. - Erreur de perspective :
Réduire la France à « récupérer l’Alsace-Lorraine » est une vision simpliste.
Correction : rôle des alliances, peur de l’encerclement allemand, tensions économiques. - Absence de nuance :
« Les rivalités coloniales et économiques ont accentué les tensions » → trop vague, sans exemple concret (ex. crise marocaine entre France et Allemagne).
Exemple version sciences
Exemple avec la physique
Consigne donnée à ChatGPT
« À quelle température l’eau bout-elle ? »
Réponse typique de l’IA
« L’eau bout toujours à 100 °C. »
Erreur à chasser
❌ Réponse incomplète : l’eau bout à 100 °C seulement à la pression atmosphérique normale (1 bar, au niveau de la mer).
Correction :
- En altitude, la pression atmosphérique est plus faible → l’eau bout à une température plus basse (ex. ~90 °C à 3000 m).
- En cocotte-minute (pression plus forte), l’eau bout au-dessus de 100 °C.
✅ La température d’ébullition dépend de la pression.
Notes et références
[1] Ioan Roxin professeur émérite à l’université Marie et Louis Pasteur « IA générative : le risque de l’atrophie cognitive » https://www.polytechnique-insights.com/tribunes/neurosciences/ia-generative-le-risque-de-latrophie-cognitive/
Titre : Your Brain on ChatGPT: Accumulation of Cognitive Debt when Using an AI Assistant for Essay Writing Task – https://arxiv.org/abs/2506.08872 (attention à la mise en ligne de l’article, l’étude est toujours en préprint).
[2] Sparrow, B., Liu, J., & Wegner, D. M. (2011). Google Effects on Memory: Cognitive Consequences of Having Information at Our Fingertips — Science, 333(6043): 776-778 – https://scholar.harvard.edu/files/dwegner/files/sparrow_et_al._2011.pdf
[3] Wang J. et al. (2025). “The Effect of ChatGPT on Students’ Learning Performance, Learning Perception, and Higher-Order Thinking.” Nature Humanities and Social Sciences Communications. https://www.nature.com/articles/s41599-025-04787-y
- C’est une méta-analyse → elle compile 51 études menées entre 2022 et 2025. C’est beaucoup plus robuste qu’une seule expérience isolée (comme le MIT).
- Résultat nuancé → elle montre que l’IA peut améliorer la performance et la motivation dans certains cas, mais que tout dépend de l’usage (assistant vs substitut).
- Dimension “higher-order thinking” → contrairement au MIT qui ne mesure que la mémoire, elle regarde aussi les compétences de réflexion de haut niveau.
- Équilibre le propos → en citant le MIT seul, on pourrait croire que l’IA est uniquement néfaste. Avec Wang et al. 2025, il est montré que les effets varient selon le cadre, ce qui sert ton argument : l’IA n’atrophie pas, elle déplace l’effort cognitif.
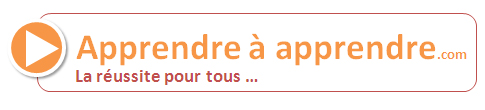
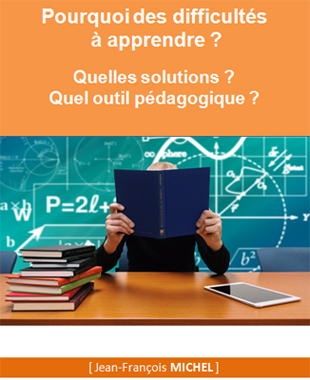
merci bon article
Bonjour,
Merci pour votre message et pour vos encouragements.
Bien cordialement
Jean-François
Ce qui me surprend, c’est cet angélisme face au danger. Quand Internet puis Google ont été disponibles à tous les élèves, il est évident que quelques élèves les ont utilisés à bon escient et leur ont permis de progresser plus vite, plus haut, plus fort. Mais on oublie que c’est à partir de là que le niveau global a chuté. Les calculatrices et autres outils informatiques ont profité aux plus forts mais la grande majorité des élèves les ont utilisés pour moins travailler, moins apprendre, moins comprendre. En maths La France est passée d’un pays ayant un des meilleurs niveaux au monde à un des plus bas en Europe… Pourtant on a injecté des milliards en machines qui, disait-on, allaient révolutionner l’enseignement et améliorer fortement le niveau…
Bonjour,
Votre argumentation est intéressante.
Mais l’IA est un fait. Il y a les nations qui adapterons leur éducation avec, et les autres qui en auront peur et resteront sur les pratiques d’il y a 20 ans.
Qui se passe de la machine à calculer aujourd’hui ? Quasiment personne. Et pour autant, cela ne baisse pas le niveau de raisonnement, de connaissance et maîtrise des mathématiques ou de la physique. Les prouesses techniques et sociétales s’accélèrent grâce à internet… pour les sociétés qui ont su s’adapter. Pour l’IA cela sera exactement la même chose. Et la France, 1er pays soviétique au monde (sources FMI) va imposer, comme elle sait le faire, normes et règles car il y a une peur, un danger. Et on connaît à chaque fois le résultat 😉 …
Bien cordialement
Jean-François
Bonjour très intéressant mais pour je n’ai pas vu les langues étrangères..
Je souhaiterais apprendre l’italien avec L’I A
Bonjour,
Merci pour votre message.
Bien cordialement
Jean-François
Très belle et pertinente analyse de l’auteur de cet article.
Tous nos encouragements !
Très belle et pertinente analyse de l’auteur de cet article.
Tous nos encouragements !
Je ne crois pas que j’ai pu lire l’article d’un trait alors que j’ étais hyper occupé à une tâche.
Mais la clarté et les précisions du contenu paragraphe par paragraphe m’ont emporté.
Il faut avouer que j’avais soif de ces explications pour relever mes propres doutes par rapport aux idées préconçues sur l’utilité de l’IA.
Je suis aujourd’hui outillé pour mieux orienter mes communications à cet effet.
Merci à toi Jean François Michel de continuer à nous nourrir à la source de tes pertinentes recherches et analyses.
Bonjour,
Merci pour votre message et pour vos encouragements. Je suis ravi que l’article vous ait plu. L’écriture est devenue ma nouvelle passion : après deux livres publiés chez Eyrolles, cela aide un peu.
Avec l’IA, j’ai l’impression de revivre le début des années 2000 avec internet. L’IA suscite des inquiétudes légitimes, certes, mais elle offre aussi énormément de côtés positifs. La société évolue avec la technologie : c’est inévitable. L’alarmisme, en revanche, me paraît peu pertinent… mais il fait vendre, il génère des clics.
C’est donc avec grand plaisir que je continuerai à traiter ces sujets éducatifs et à publier.
Bien cordialement,
Jean-François