Dernière modification de l’article le 20 septembre 2025 par Admin
Les notes.
Ces petits chiffres qui tiennent dans un coin de page… et qui pèsent parfois des tonnes sur les épaules d’un enfant.
Pour les parents, elles sont comme un baromètre de l’avenir : un 18 rassure, un 7 inquiète, un 3 fait trembler toute la maison.
Pour les jeunes, elles ressemblent à un verdict sans appel : la note à l’école devient leur identité.
Et souvent, ce simple chiffre agit comme un poison lent : il ne sanctionne pas seulement une copie, il s’infiltre dans la confiance, il grignote l’envie d’apprendre.
Alors, pour éviter ce drame silencieux, certains enseignants dégainent les couleurs.
Vert pour l’encouragement.
️ Orange pour l’avertissement.
⛈️ Rouge pour la vigilance.
En primaire, ce code couleur adoucit la morsure des notes.
Dans quelques collèges, même en 6e ou 5e, les couleurs remplacent les chiffres pour retarder ce choc émotionnel.
Mais une question persiste, tenace :
Ne faut-il pas supprimer les notes ?
Et si oui, comment continuer à évaluer ? Car tôt ou tard, un élève devra se confronter à une mesure, un barème, un chiffre.
Et si le problème n’était pas la note elle-même… mais l’histoire que nous nous racontons autour de cette note ? Une histoire qui touche autant la pédagogie que la psychologie et l’éducation.
Article et texte écrits par Jean-François MICHEL Auteur « Les 7 profils d’apprentissage » Éditions Eyrolles 2005, 2013, 2019 et 2024
« Très bon devoir, au‑delà de mes espérances ! »
Je revois encore leurs yeux grands ouverts.
Mes élèves de lycée technique, assis devant moi, avec un mélange d’inquiétude et de désinvolture.
C’était le tout premier contrôle d’économie de l’année.
Je savais que ça allait être mauvais. Toujours.
Ces jeunes, persuadés que « ça allait passer », n’avaient pas révisé.
Je connaissais la scène par cœur.
Avant de rendre les copies, les questions fusaient :
— Monsieur, vous avez corrigé ?
— Oui… et le travail est excellent. Je suis très content.
Je voyais leurs visages s’illuminer.
Un soupir de soulagement.
Certains souriaient déjà, convaincus qu’ils avaient réussi.
Puis les copies sont tombées sur les tables.
Silence! Stupeur.
Presque personne n’avait la moyenne.
Les regards ont changé instantanément.
Les épaules se sont affaissées.
Dans la salle, l’air est devenu lourd, comme si un rideau de plomb venait de tomber.
L’incompréhension de mes élèves est totale. Et sur leur visage j’arrive facilement à lire leur état d’esprit : « Notre prof se fiche de nous!» Alors j’ai dit, doucement :
« Si si, c’est parfait. Vous avez fait toutes les erreurs en une seule fois. En début d’année c’est normal. Et même pour certains c’est au-delàs de mes espérances. »
Face à une classe en état de sidération, je laissais volontairement un silence pour laisser les esprits imprégner ce nouvel angle de vue.
Et je poursuivais
« Vous avez droit à l’erreur.
Mais la prochaine fois, ces erreurs-là… je ne veux plus jamais les voir. »
De la provoque ? Un peu oui. Le fait s’avoir été formé par le célèbre Franck Farelly doit y être pour quelque chose.
Franck Farelly ? Je sais, vous ne connaissais pas.
C’est un génie, du même niveau qu’un Milton Erickson, dont le travail a été repris par le monde de la psychologie et de la thérapie. Sa pratique et ses idées ont été reprises et modélisées par les fondateurs de la programmation neuro linguistique (PNL) R. Bandler & J. Grinder.
Sa vision : faire sauter un schéma répétitif et limitant par une action disruptive pour changer d’angle de vue.
J’en reparlerai dans un autre article probablement.
Pour en revenir à notre sujet : la note n’est pas le problème.
Le problème, c’est l’histoire que chacun se raconte autour de cette note, la façon de la considérer et de l’interpréter.
Bref une question d’angle de vue… on y revient.
Une première mauvaise note ?
Pour l’élève c’est : « Je suis nul. »
Pour les parents : « Il va rater sa vie. »
Pour l’enseignant : « Ils n’ont rien compris. »
Alors que ce premier devoir catastrophique était, pour moi, une bénédiction.
C’était mon point de départ, leur terrain d’entraînement.
Une mauvaise note, quand on la lit correctement, n’est pas une condamnation, c’est un message, un guide, parfois même un tremplin.
Trois classes. Trois approches. Trois récits possibles à partir d’une simple évaluation.
Dans une école 261 élèves (moyenne d’âge : 12,3 ans) ont été répartis au hasard dans trois groupes de 9 classes [1] :
- Groupe 1 (≈ 88 élèves) : une note seule, déposée sans explication.
- Groupe 2 (≈ 90 élèves) : la note + un commentaire standard, générique mais présent.
- Groupe 3 (≈ 83 élèves) : la note + un commentaire personnalisé, ciblé sur les forces et les axes de progrès.
Au terme de cette expérience (sessions réparties sur deux jours), le verdict est clair :
- Le groupe sans feedback stagne ou régresse sur la motivation et la performance durant toute la session de l’expérience.
- Celui avec un commentaire standard fait mieux.
- Mais le groupe bénéficiant d’un feedback personnalisé explose ses résultats à la session suivante, particulièrement sur des tâches ouvertes et créatives.
Autrement dit : la note pose une fondation, mais c’est le commentaire qui bâtit le pont vers l’apprentissage.
Parmi ces élèves, seulement ceux ayant eu un retour réfléchi — de non-jugement — ont voulu reprendre le défi. Dans le groupe « commentaires personnalisés », 70 % reconnaissent que leur effort venait de l’intérêt suscité, et non pas de la peur de la note. Comparez cela au groupe « note seule », où 26 % attribuent leur effort à l’évitement d’un échec.
Bloom et ses collègues (1981) l’avaient déjà pressenti : l’évaluation peut être une fleur ou un fardeau, selon qu’on lui ajoute de la chaleur ou qu’on la laisse froide et sèche.
Ce que montre Butler (1988), dans le British Journal of Educational Psychology, est limpide [2] :
- Le feedback qui parle effort, stratégie, intérêt, est un carburant puissant pour la motivation intrinsèque.
- Un feedback centré sur l’ego ou le jugement — même positif — peut tendre vers la dépendance du regard extérieur, voire provoquer une baisse de performance en cas de difficulté.
Et si la note était un feu ?
Un feu qui peut réchauffer… ou brûler.
C’est exactement ce que Kluger & DeNisi ont découvert après avoir passé 131 études et 607 effets de feedback au microscope [3].
Ils cherchaient à savoir :
Le feedback allume-t-il la flamme de l’apprentissage… ou souffle-t-il dessus jusqu’à l’éteindre ?
Le verdict est saisissant :
- 62 % des feedbacks rallument la flamme.
- 38 % l’éteignent.
Le secret ? La direction de la lumière.
- Quand le feedback éclaire la tâche, il devient une lanterne sur le chemin.
- Quand il se rapporte à l’ego, au jugement – « Tu es nul » ou même « Tu es doué » – il devient un projecteur aveuglant qui fige l’élève sur place.
Et nos notes, dans tout ça ?
Elles sont souvent des chiffres nus, des éclairs froids dans le ciel de l’élève et claquent comme un coup de tonnerre :
« 8/20… »
Puis le silence.
Sans explication, la note est un verdict, pas une boussole.
Mais dès qu’on y ajoute un commentaire clair, centré sur le prochain pas à franchir, la note change de nature : elle devient un caillou blanc sur le sentier, un repère pour continuer à avancer.
C’est là que l’histoire rejoint la pédagogie nordique.
Dans plusieurs pays, comme la Finlande, la Suède ou le Danemark, on a choisi de retirer le thermomètre plutôt que de laisser les élèves geler sous la peur des notes.
Dans ces systèmes :
- Les premières années, aucune note chiffrée n’est donnée.
- Les élèves reçoivent des feedbacks riches, sous forme de couleurs, de commentaires ou d’entretiens individuels.
- L’idée : protéger la curiosité comme une jeune pousse, avant d’y apposer des chiffres qui risquent de la casser.
Les résultats ?
Une motivation plus forte, moins d’angoisse scolaire, et des élèves qui comprennent que l’erreur est une marche d’escalier, pas un précipice.
Mais il y a quelques échecs à noter et des réflexions au retour de la note.
Même en France, certaines écoles primaires ou collèges ont tenté cette approche avec des codes couleurs jusqu’à la 6e et même 5e :
Vert pour « acquis », orange pour « en progrès », rouge pour « à consolider ».
Un système pensé comme un arc-en-ciel pédagogique, pour éviter que l’élève ne s’enferme dans la prison des chiffres.
Alors, la question n’est pas seulement « faut-il supprimer les notes ? ».
Elle est bien plus subtile : comment transformer le feu des notes en chaleur qui élève, plutôt qu’en brûlure qui décourage ?
Quelle note vous vous donnez ?
Quand j’enseignais dans le supérieur à Dresde, beaucoup de mes élèves envisageaient un séjour à l’étranger.
Certains rêvaient de poursuivre leurs études dans une autre université, d’autres voulaient simplement travailler ailleurs pendant une césure.
Ce dépaysement était même encouragé par l’école.
Mais avant de partir, ils devaient franchir une étape cruciale : la soutenance de leur mémoire.
Un exercice qui comptait pour 40 % de la note finale… Autant dire que ça pesait lourd.
Je voulais que cette évaluation soit utile, pas seulement punitive.
Alors j’avais préparé une grille d’évaluation claire :
- qualité d’écriture,
- structure du mémoire,
- pertinence du contenu,
- et surtout… est-ce que le sujet était vraiment traité ?
Chaque critère était noté de 0 à 10, avec une pondération selon son importance.
Mais ce qui changeait tout, c’était l’auto-évaluation.
Pendant la soutenance, je remplissais ma grille…
Lorsque l’élève avait fini sa soutenance, je lui tendais une grille vierge, et lui proposais de remplir la sienne. Bref, une auto-évaluation.
Une fois fait, nous comparions nos grilles d’évaluation et donc nos notes.
Le résultat était saisissant : à 90% la comparaison était quasi similaire.
Les étudiants comprenaient d’eux-mêmes où leur travail tenait la route… et où il s’écroulait.
Ceux qui s’étaient lancés à la dernière minute reconnaissaient leurs faiblesses sans que mon collègue et moi-même ne devions le souligner.
La note devenait un miroir, pas un couperet.
Au lieu de créer des frustrations, ce système apaisait.
Les élèves repartaient avec un vrai feedback, souvent motivés à corriger le tir pour le rattrapage.
Et mes collègues et moi-même, avions le sentiment de leur avoir donné un outil pour progresser, pas seulement un chiffre.
Avec le recul, c’est ce miroir qui fait toute la différence.
Une note seule peut blesser ou décourager.
Mais quand l’élève s’évalue lui-même, la note devient une boussole qui montre la direction à prendre.
L’auto-évaluation : que dit la science ?
Imaginez un élève perdu dans une forêt épaisse.
Les notes, ce sont parfois des éclairs dans le ciel : elles éclairent un instant… puis laissent l’élève dans le noir.
L’auto-évaluation, elle, agit comme une boussole qu’on glisse dans sa main.
Les études sont limpides.
Dans Frontiers in Education, on observe que lorsqu’un élève s’auto-évalue avec une grille claire, il cesse de marcher au hasard.
Il trace son chemin, il planifie, il observe ses pas, il ajuste sa trajectoire.
L’erreur ne devient plus une chute, mais une pierre sur laquelle s’appuyer pour monter plus haut.
Panadero et Romero (2014) l’ont montré avec précision [5] :
L’auto-évaluation structurée active les trois muscles de l’apprentissage autorégulé :
Planification + Performance + Réflexion.
Trois piliers qui transforment l’élève en grimpeur capable d’atteindre des sommets.
Et les chiffres le confirment.
Une méta-analyse de 2022 sur l’auto-évaluation [5 et l’évaluation par les pairs montre des résultats concrets :
- Des progrès scolaires mesurables,
- Une motivation qui ne dépend plus de la peur,
- Une anxiété qui fond comme neige au soleil.
McMillan et Hearn (2008) vont plus loin :
Lorsqu’un élève apprend à se juger lui-même, la note perd son pouvoir de sanction.
Elle n’est plus qu’un panneau sur le chemin.
La peur s’efface, l’élève reprend les rênes.
Alors, voulons-nous continuer à tendre aux élèves des éclairs qui effraient…Ou leur donner une boussole qui guide ?
Une note seule peut être un poison alors que l’auto-évaluation la transforme en potion, capable de nourrir la progression et l’envie d’apprendre.
Transformer l’erreur en tremplin
Dans mon lycée technique, cette première note n’était qu’un étalonnage.
Je voulais que mes élèves comprennent : « Ton intelligence ne se résume pas à un chiffre. »
En observant leur progression, je finissais même par effacer ce premier résultat perçu comme catastrophique.
Pourquoi ? Parce qu’une note n’a de sens que si elle ouvre une porte.
Si elle ferme des esprits, elle détruit la motivation.
Si elle éclaire le chemin à suivre, elle devient un tremplin.
Et si nous changions notre regard ?
Chaque note est un message : mal interprété, il décourage, bien accompagné, il libère le potentiel.
Alors, au lieu de demander « Combien j’ai eu? », si on commençait par demander :
« Qu’est‑ce que cette note t’apprend sur toi ? »
C’est cette question qui transforme une mauvaise note en moteur, et qui fait de nous des enseignants qui éveillent, plutôt que des enseignants qui classent.
Ce qu’il faut retenir
• La note seule est un feedback évaluatif brut, souvent perçu comme un jugement → risque de décourager surtout les élèves fragiles.
• L’impact négatif de la note peut être neutralisé si elle est accompagnée d’un feedback clair, centré sur la tâche et orienté amélioration.
• Pour motiver durablement, le chiffre ne suffit pas : l’élève a besoin de comprendre quoi faire pour progresser.
C’est là tout l’enjeu, au croisement de la pédagogie, de la psychologie et de l’éducation. La note, en soi, n’est ni condamnant ni rédempteur.
Elle peut devenir toxique si elle est déconnectée du sens, délivrée sans explication.
Par contre, une note suivie d’un retour clair, bienveillant et constructif, transforme un choc en point de départ vers la progression.
Comme toujours, tout est une question de perception.
Sources et références
Études examinant l’impact du feedback sans affichage immédiat de la note
[1] Impact of Displaying Grades vs. Feedback
Une recherche récente (publiée il y a environ 6 mois) montre que ne pas afficher immédiatement les notes, tout en fournissant un feedback constructif, peut renforcer le sentiment de contrôle et la motivation intrinsèque des élèves. L’absence temporaire de chiffre permet à l’élève de se concentrer sur le contenu et non sur le verdict : https://www.researchgate.net/publication/345363202_A_meta-analysis_on_the_impact_of_grades_and_comments_on_academic_motivation_and_achievement_a_case_for_written_feedback
L’étude dans son intégralité : « Impact of Displaying Grades Vs. Not Displaying Grades on Academic Performance and Emotional Outcomes While Delivering Feedback Comments: A Longitudinal Study » https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10627197.2025.2455128
[2] Butler, Nisan & al. (années 1980) / Butler, R. (1988). Enhancing and undermining intrinsic motivation: The effects of task-involving and ego-involving evaluation on interest and performance. British Journal of Educational Psychology,58(1), 1-14.
Une expérience comparant trois groupes d’élèves :
- note seule,
- note + commentaire standard,
- note + commentaire personnalisé.
Résultat : seuls les groupes ayant reçu des commentaires (même standardisés) progressent significativement sur l’évaluation suivante. Le groupe avec commentaires personnalisés affiche les meilleurs gains
Conclusion : la note ne suffit pas. C’est la nature du commentaire, orienté vers l’investissement futur, qui fait la différence.
Bloom, B. S., Madaus, G. F., & Hastings, J. T. (1981). Evaluation to improve learning. New York, NY: McGraw-Hill.
[3] Kluger, A. N., & DeNisi, A. (1996). The effects of feedback interventions on performance: A historical review, a meta‑analysis, and a preliminary feedback intervention theory. Psychological Bulletin, 119(2), 254‑284.
Cet article rigoureux passe en revue 607 effets de différents types de feedback, et montre que le feedback peut améliorer ou au contraire détériorer la performance, selon sa forme, son contexte et son orientation – https://www.researchgate.net/publication/232458848_The_Effects_of_Feedback_Interventions_on_Performance_A_Historical_Review_a_Meta-Analysis_and_a_Preliminary_Feedback_Intervention_Theory
Résumé de l’étude
- Objet de l’étude : Comprendre l’impact des interventions de feedback sur la performance à travers une analyse de 607 effets tirés de 131 études.
- Résultat global :
- 62 % des feedbacks ont amélioré la performance.
- 38 % des feedbacks l’ont détériorée.
- Facteur clé : La nature du feedback.
- Feedback centré sur la tâche → effet positif sur l’apprentissage et la performance.
- Feedback centré sur la personne (ex. « Tu es nul » ou « Bravo, tu es doué ») → tendance à réduire la performance.
- Explication :
Les feedbacks qui recentrent l’attention sur soi (ego, jugement) perturbent la motivation et l’autorégulation, tandis que ceux qui apportent des indications concrètes sur comment progresser stimulent l’apprentissage.
Auto-évaluation et régulation de l’apprentissage
[4] Une revue publiée dans Frontiers in Education montre que les élèves qui pratiquent une auto-évaluation guidée — via des grilles ou des scripts — développent une meilleure autorégulation : planification, suivi et capacité de réflexion sur leurs erreurs. L’effet varie de modéré à important (η² = 0,06 à 0,42) mais toujours significatif – https://www.frontiersin.org/journals/education/articles/10.3389/feduc.2019.00087
« Grading anxiety with self and peer-assessment: A mixed-method study in an Indonesian EFL context » https://www.iier.org.au/iier30/nawas.pdf
Méta-analyse : effets des interventions d’auto- et peer-évaluation
[5] Une méta-analyse récente (2022) sur la combinaison d’auto-évaluation (SA) et d’évaluation par les pairs (PA) montre que ces pratiques améliorent significativement les résultats scolaires. Elles favorisent la compréhension des critères, la motivation intrinsèque et des apprentissages plus profonds. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1747938X22000537
Motivation accrue et réduction de l’anxiété
McMillan & Hearn (2008) dans Student Self-Assessment: The Key to Stronger Student Motivation and Higher Achievement (ERIC) démontrent qu’une auto-évaluation bien intégrée :
- accroît la motivation intrinsèque,
- installe une orientation vers la maîtrise des compétences plutôt que la simple performance,
- permet aux élèves d’identifier eux-mêmes leurs difficultés et leurs stratégies d’amélioration
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ815370.pdf
Panadero & Romero (2014) soulignent une association claire entre auto-évaluation référencée à une grille, et une progression dans les trois phases de l’apprentissage autorégulé : planification, performance, réflexion.
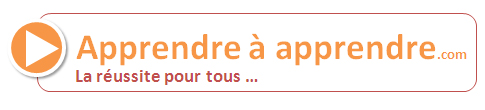

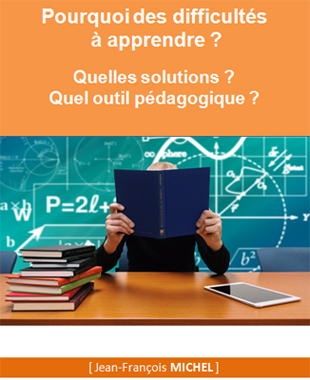
merci de partager cet article très instructif.
Bonjour,
Merci! pour votre message 🙂
Bien cordialement
Jean-François
Merci pour ce passionnant article qui étaient ce que j’ai appris en formation et me confirme les pistes à suivre.
Des évaluations pertinentes + un travail sur la confiance et l’estime de soi aident les élèves à sortir des schémas de pensée négatifs.
Merci pour votre travail en général.
Bonjour,
Merci pour votre message d’encouragement. C’est ce qui me donner l’énergie à continuer 🙂
En vous souhaitant une bonne journée
Jean-François
Merci beaucoup pour votre excellent travail d’information et sensibilisation.
Bonjour,
Merci pour votre message d’encouragement.
En vous souhaitant une bonne journée
Bien cordialement
Jean-François
Excellent article et très utile à la veille de la rentrée 2025
Bonjour,
merci pour votre message 🙂
Bien cordialement
Jean-François
Bonjour, vos propos et les études qui les étayent sont tellement vrais: dans notre système d’éducation les notes sanctionnent, stigmatisent et in fine discriminent d’emblée les élèves entre eux. On souhaiterait des évaluations pertinentes, ayant un sens, celui de la motivation et de la progression, comme celui du monde professionnel, où le salarié est invité à donner son avis sur son parcours professionnel, ses qualités, sa qualité de vie au travail mais aussi les points sur lesquels il souhaite progresser, les formations complémentaires qui pourraient lui permettre d’atteindre ses objectifs.
Les rencontres parents professeurs vont dans le sens de ces notes sans commentaires personnalisés: les élèves sont des spectateurs du dialogue entre les professeurs et les parents, alors que ce sont eux qui sont concernés. J’ aimerais que l’élève soit replacé au centre de ces entretiens, qu’il soit acteur de sa vie scolaire et qu’il soit aidé à fixer des objectifs personnalisés pour progresser, voire même avoir la possibilité de repasser des évaluations sur les points qui ont fait défaut afin de valider l’ensemble des compétences attendues à la fin de son année scolaire.
Ce sera peut-être un sujet à aborder avec les enseignants de nos enfants afin de semer une graine d’ ouverture d’esprit.
Cordialement
Bonjour,
Merci pour votre message et votre commentaire.
Vous touchez du doigt une évidence : replacer l’élève au centre de son apprentissage. Mais la réalité est souvent plus crue. Les enseignants n’ont pas toujours le temps, ni la disponibilité pour mener ce travail en profondeur. Et du côté des parents, les a priori freinent aussi l’ouverture d’esprit.
Aujourd’hui, une autre dérive complique encore les choses : les étiquettes. Dys, TDAH, HPI, HPE… Derrière ces mots, l’enfant est parfois victimisé, déresponsabilisé. Comme si un acronyme suffisait à expliquer son parcours scolaire.
C’est précisément pour cela que j’ai écrit une version “parents” des 7 profils d’apprentissage. Parce qu’à la maison aussi, il existe des leviers concrets pour redonner du pouvoir à l’enfant et transformer son rapport à l’école.
Mon conseil : faites, chacun, à votre mesure. Avec vos moyens. Les élèves sentent quand on croit en eux. Les parents aussi. Et ce sentiment-là, aucun système d’évaluation, aucune case, aucune étiquette ne pourra jamais l’éteindre.
Bien cordialement
Jean-François