Dernière modification de l’article le 20 septembre 2025 par Admin
Vous avez déjà entendu cette phrase, n’est-ce pas ?
« Il ne faut pas mettre les élèves dans des cases. »
C’est devenu un mantra pédagogique, une formule magique que l’on ressort à tout-va dans les formations, les conférences et les débats éducatifs.
Une de ces phrases qu’on n’ose plus remettre en question, de peur de passer pour rétrograde ou rigide.
Elle sonne bien, elle a un parfum de bienveillance, elle donne l’illusion qu’on protège les élèves.
Mais si vous prenez deux minutes.
Juste deux.
Et que vous comprenez ce que fait réellement le cerveau humain quand il apprend…
alors vous verrez à quel point cette idée — en apparence généreuse — repose sur une erreur de logique et de perception monumentale.
Article et texte écrits par Jean-François MICHEL Auteur « Les 7 profils d’apprentissage » Éditions Eyrolles 2005, 2013, 2019 et 2024 
Ce que les chercheurs savent. Et que certains « experts » ignorent.
Saviez-vous que le cerveau, lui, adore mettre dans des cases ?
C’est même sa fonction principale.
Il trie, il classe, il regroupe, il simplifie.
Il le fait depuis la nuit des temps, et il continue à le faire même quand on lui interdit.
Pourquoi ?
Parce que sans catégories, le monde est un chaos.
Et dans le chaos, on ne pense pas, on survit.
Les travaux menés par le Max-Planck Institute of Neurobiology l’ont démontré avec une clarté désarmante [1] : le cerveau humain organise spontanément presque tout ce qu’il rencontre en catégories mentales.
C’est sa manière de rendre le monde compréhensible, de transformer la complexité du réel en structures exploitables. Il ne cherche pas la nuance en premier, il cherche l’économie cognitive. Et pour ça, il classe.
Ce mécanisme n’est pas une lubie humaine. Il est tellement fondamental qu’on l’observe même chez la souris. Oui, des neurones spécifiques s’activent non pas en fonction d’un objet en soi, mais selon la catégorie à laquelle cet objet appartient. Ce n’est donc pas la chose que le cerveau reconnaît d’abord, c’est la boîte dans laquelle il peut la ranger.
Autrement dit, le cerveau ne se demande pas « qu’est-ce que c’est ? », mais plutôt « à quoi est-ce que ça ressemble ? »
Il ne cherche pas le détail d’entrée de jeu, il cherche la ressemblance, la correspondance avec ce qu’il sait déjà.
Et il le fait tout seul, en permanence.
Parce que sans ça, il serait débordé, littéralement paralysé par la nouveauté constante.
D’ailleurs, une revue de psychologie cognitive et de neurosciences consacrée à l’apprentissage des catégories (The Cognitive Neuroscience of Category Learning) [2] va plus loin encore.
Elle explique comment le fait de catégoriser mobilise des fonctions cérébrales essentielles : la perception, l’attention, la mémoire de travail, la prise de décision, et même le système de récompense. On y retrouve l’implication du cortex préfrontal, des ganglions de la base, de l’hippocampe. Rien de secondaire, donc. Il s’agit du cœur même de la cognition.
Mais ce qui est fascinant, c’est de comprendre pourquoi ce mécanisme est non seulement naturel, mais aussi indispensable.
Depuis les origines, notre cerveau a dû apprendre à répondre vite : cette silhouette à l’horizon est-elle une menace ? Cette baie est-elle comestible ? Ce son est-il familier ou inquiétant ?
Chaque fois, la réponse passe par une simplification immédiate : danger ou sécurité, connu ou inconnu, utile ou inutile.
Pas de temps pour l’analyse fine. Il faut agir.
Et agir vite, c’est catégoriser.
Catégoriser, c’est aussi économiser.
Le cerveau est une machine gloutonne, mais paresseuse. Il consomme énormément d’énergie, alors il optimise tout ce qu’il peut.
Plutôt que de tout analyser depuis zéro à chaque fois, il crée des modèles. Des analogies.
Ceci ressemble à cela ? Alors je sais déjà comment réagir.
C’est une stratégie de recyclage cognitif, intelligente et redoutablement efficace.
Plusieurs études récentes viennent clairement l’attester. Par exemple, des travaux publiés dans Journal of Neuroscience (2021) [3] démontrent que, dès l’apprentissage de catégories auditives, le cerveau montre une activation coordonnée des réseaux fronto‑temporel‑pariétaux : notamment les zones dédiées à la perception, l’attention et la mémoire, avec un net renforcement au fur et à mesure que l’apprentissage progresse [4].
Ces recherches montrent que, lorsque nous classons des sons selon leurs caractéristiques, notre cerveau active non seulement les zones sensorielles, mais aussi celles impliquées dans le traitement abstrait et la décision éclairée.
Par ailleurs, une étude récente sur la catégorisation visuelle révèle un phénomène appelé « catégorie‑biased neural representations », publié dans Journal of Neuroscience en 2022 [5]: lors de l’apprentissage, non seulement les items de la même catégorie sont perçus comme plus similaires, mais cette différence est lisible au niveau neuronal, avec une nette distinction activée par le cortex visuel.
Enfin, une étude récente, publiée en 2023 dans la revue scientifique eLife, a présenté un modèle informatique avancé (suivi d’un preprint en 2025) [6] qui démontre que l’interaction entre le cortex préfrontal et l’hippocampe est cruciale pour apprendre à classer et à généraliser dans des contextes nouveaux, consolidant ainsi l’idée que ces zones ne sont pas périphériques dans l’apprentissage, mais bien centrales.
Ainsi, toutes ces découvertes récentes soutiennent l’idée que la catégorisation mobilise en simultané :
- la perception (pour différencier les stimuli),
- l’attention (pour focaliser sur les traits distinctifs),
- la mémoire (pour stocker les exemples et généraliser),
- la prise de décision (pour appliquer des règles ou segments appris).
Catégoriser, enfin, c’est apprendre.
Quand un enfant apprend à reconnaître un triangle, il ne mémorise pas chaque triangle individuellement. Il crée une catégorie mentale, avec ses critères : trois côtés, trois angles, figure fermée.
Et cette logique s’applique à tout le champ scolaire : les types de texte, les classes grammaticales, les stratégies de calcul, les émotions, les profils d’élèves.
S’il n’y a pas de catégorie, il n’y a pas de cadre.
Et, s’il n’y a pas de cadre, il n’y a pas de mémoire, donc pas d’apprentissage.
Voilà pourquoi toutes les tentatives pour « éviter les cases » sont non seulement inefficaces, mais contre-productives.
Car refuser les catégories explicites ne supprime pas la catégorisation.
Elle ne fait que laisser le cerveau improviser seul, avec les raccourcis qu’on connaît bien : les bons versus les mauvais, les forts versus les faibles, les intelligents versus les idiots.
Et cela concerne aussi le débat sur les profils d’apprentissage.
Certains les rejettent sous prétexte qu’ils « enferment les élèves dans des cases ».
Vous comprenez que c’est une confusion grossière sous le prisme de l’ignorance du fonctionnement même du cerveau.
Les profils d’apprentissage ne sont pas des cases définitives. Ce sont des points de départ, des repères représentés sur une carte, même si la carte n’est pas le territoire comme le dit si bien Alfred Korzybski.
Il est bon de rappeler qu’un profil d’apprentissage est un outil, une boussole pédagogique, pas une prison.
Et face à des jeunes qui cherchent à se comprendre, leur refuser cette carte sous prétexte d’un purisme théorique, c’est leur demander de s’orienter sans guide, à l’aveugle.
En pédagogie, la catégorisation est une bénédiction. Pourquoi ?
Elle permet de structurer les contenus, de clarifier la progression, d’installer des routines mentales solides.
Elle favorise la mémorisation, car chaque nouvelle information trouve une place dans un réseau déjà existant.
Et elle accélère l’autonomie, car les apprenants peuvent mobiliser plus facilement ce qu’ils ont appris dans de nouveaux contextes.
En pratique, cela signifie très simplement :
– Présenter les contenus par familles, types, classes, catégories
– Utiliser des exemples représentatifs de chaque catégorie
– Construire des cartes mentales qui rendent visibles les liens logiques
– Proposer des activités de tri, de regroupement, de classement
– Encourager la comparaison, la différenciation, la reconnaissance des invariants
Ce n’est ni nouveau, ni révolutionnaire.
Mais c’est profondément efficace.
Et surtout, c’est respectueux du fonctionnement réel du cerveau humain.
Alors, non. Catégoriser, ce n’est pas enfermer.
C’est offrir un cadre pour penser, comprendre, mémoriser, décider.
Et oui, le cerveau met les choses dans des cases.
Ce n’est pas une faiblesse. C’est une force.
Ce qui compte, ce n’est pas d’empêcher les cases.
C’est de choisir lesquelles on transmet, et d’apprendre à les redessiner, à les affiner, à les dépasser.
C’est ça, le vrai rôle du pédagogue.
Pas d’éviter les cases.
Mais d’apprendre à penser avec elles.
Et au besoin, à penser au-delà.
Mais voilà… l’erreur des psychologues
Des psychologues et même quelques neuropsychologues (le préfixe « neuro » ça fait quand mieux) répètent à longueur de conférences et d’articles :
« Il ne faut pas catégoriser ! »
Et pire encore :
« Les profils d’apprentissage ? C’est dangereux…Ça met les élèves dans des cases. »
À croire qu’ils n’ont jamais mis les pieds dans une classe.
À croire qu’ils n’ont jamais vu un élève en vraie difficulté, chercher un repère.
Un point d’ancrage.
Une stratégie qui lui correspond.
Résultat ?
Mais voilà.
À force de répéter qu’il ne faut surtout pas catégoriser, certains professionnels finissent par oublier une chose essentielle : ce n’est pas parce que l’on refuse d’enseigner des catégories claires que le cerveau, lui, va s’arrêter de le faire.
Bien au contraire.
Le cerveau continue de catégoriser. Toujours. C’est automatique. C’est son fonctionnement de base. Sauf que sans accompagnement pédagogique, sans carte mentale précise, sans repères fournis intentionnellement par l’enseignant ou le formateur, il le fait à l’instinct. Au gré des impressions, de l’environnement, du climat social ou scolaire.
Et devinez ce que cela donne ?
Au lieu d’une représentation structurée et nuancée de sa façon d’apprendre — comme une carte routière mentale qui permettrait à l’élève de se repérer, de s’orienter, de progresser — le cerveau fabrique des catégories simplistes. Rapides. Brutales.
Il ne se dit pas : « Je retiens mieux en visualisant », ou « J’ai besoin d’un cadre pour me concentrer ».
Non.
Il se dit : « Je suis nul », « Je suis pas fait pour ça », « Je ne comprends jamais rien », ou pire encore : « Les autres sont meilleurs que moi ».
Et la catégorisation spontanée devient toxique :
Mauvais élève vs bon élève.
Bête vs intelligent.
Capable vs foutu d’avance.
Voilà ce qui se passe quand on refuse de donner des repères clairs.
Le cerveau les invente tout seul.
Et il ne choisit pas les plus bienveillants.
Il prend les plus visibles. Les plus simples. Les plus impitoyables.
Alors à ceux qui disent « ne mettons pas les élèves dans des cases », on peut répondre ceci :
Si vous ne leur proposez pas des catégories utiles, structurantes, évolutives…
Ils iront se mettre seuls dans des cases.
Et souvent, ce ne seront pas les bonnes.
D’où provient cette croyance d’éviter de catégoriser ?
Pendant des décennies, une idée a doucement contaminé l’éducation, la psychologie et même la pédagogie :
« Mettre les gens dans des cases, c’est mal. »
Une évidence… qu’on ne questionne plus. Mais pourquoi ? Quelle est l’origine de cette croyance devenue réflexe ?
Elle est née de plusieurs courants puissants :
- La psychologie humaniste (Carl Rogers, Abraham Maslow).
Elle valorisait la singularité de chaque individu.
Elle refusait qu’une personne soit réduite à un diagnostic ou à une étiquette.
L’intention était belle : protéger l’unicité, révéler le potentiel.
- Les grands mouvements contre les discriminations (féminisme, antiracisme, défense des personnes en situation de handicap).
Ils ont dénoncé avec raison les stigmatisations, le racisme, le sexisme, le validisme.
Ils ont voulu couper le lien entre « catégorie » et « préjugé ».
- Le relativisme postmoderne (Foucault, Derrida, Deleuze…).
Il a remis en cause les hiérarchies, les normes, les grandes classifications imposées par les institutions.
Tout cadre était suspect.
Tout classement, un acte de domination.
Résultat ?
Petit à petit, « mettre dans une case » est devenu synonyme de réduire, enfermer, condamner.
Et cette croyance s’est glissée partout : dans l’école, dans la psychologie, dans les discours des soi-disant experts en neurosciences.
Mais voilà le vrai problème :
On a confondu catégoriser pour comprendre et juger pour enfermer.
On a jeté le bébé avec l’eau du bain.
En refusant de créer des catégories pédagogiques, on prive les élèves d’une carte mentale pour se repérer.
Et le cerveau, lui, ne s’arrête pas pour attendre qu’on l’autorise à classer.
Il classe quand même.
Mais sans nuances, sans guide, sans intelligence.
Et alors, les cases qu’il crée sont brutales :
Bon… Mauvais.
Intelligent… Bête.
Capable… Nul.
En voulant éviter les cases, on a laissé les plus cruelles s’installer.
Et en pédagogie, ça donne quoi ?
Et en pédagogie, concrètement, qu’est-ce que cela change ?
Tout.
Parce que si vous n’offrez aucune catégorie explicite à vos élèves, si vous les laissez seuls face à une masse d’informations sans structure, sans point d’ancrage, sans regroupement clair… alors ils devront bricoler leurs propres repères, à l’instinct, avec les moyens du bord.
Et dans l’immense majorité des cas — disons-le franchement, dans plus de 80 % des situations — ce bricolage tourne mal.
Non pas parce que les élèves sont paresseux, ou incapables, mais parce que le cerveau, privé de structure, fait ce qu’il peut : il tâtonne, il copie, il mémorise mal, ou pire, il renonce.
Il subit au lieu de construire.
Il empile des informations sans lien entre elles, sans vision d’ensemble, sans fil conducteur.
Et ce qui aurait pu devenir un savoir opérationnel reste une suite d’éléments dispersés, vite oubliés.
Mais si, au contraire, vous proposez des catégories mentales claires, des regroupements visibles, des distinctions bien posées, alors tout change immédiatement.
Le cerveau respire.
Il comprend ce qu’on attend de lui.
Il peut raccrocher les nouvelles informations à des structures existantes.
L’attention devient plus stable, parce qu’il sait où regarder.
La compréhension s’installe, parce qu’il perçoit les logiques internes.
La mémorisation s’active, parce que chaque élément trouve naturellement sa place dans un cadre plus large.
Et surtout, le transfert devient possible : l’élève peut reconnaître une situation nouvelle comme étant de la même famille que ce qu’il connaît déjà, et appliquer spontanément ce qu’il a appris.
Autrement dit : une pédagogie qui repose sur des catégories explicites ne simplifie pas la pensée, elle l’architecture.
Elle ne réduit pas la complexité du monde, elle lui donne une forme accessible.
Et dans un monde où l’information déborde de toutes parts, cette capacité à ordonner, structurer, regrouper, est bien plus précieuse que le simple fait d’accumuler du contenu.
C’est aussi cela, transmettre.
Pas seulement donner à voir.
Mais aider à organiser ce qui est vu.
Et offrir, au passage, une méthode pour apprendre à penser.
️ Ce que vous pouvez faire concrètement
Ce que vous pouvez faire concrètement en classe ou en formation n’a rien d’ésotérique. Ce n’est pas une méthode miracle réservée à une élite pédagogique.
C’est une manière de structurer l’apprentissage pour qu’il devienne réellement opérant, transformant, et surtout, durable.
Et cela commence par un principe simple : on n’apprend jamais dans le vide. On apprend toujours en reliant le nouveau à ce qui déjà connu.
C’est pourquoi la première chose à faire, c’est d’organiser vos contenus en catégories explicites.
Pas pour ranger de façon scolaire, mais pour donner à l’élève une carte mentale dans laquelle il va pouvoir situer ce qu’il découvre.
Quand vous présentez les types de textes, les formes de raisonnement, les erreurs récurrentes à éviter, vous ne listez pas du savoir. Vous construisez des repères.
Et ces repères, s’ils sont clairs, permettent de relier immédiatement une notion nouvelle à une structure déjà connue. L’élève ne se dit plus : « encore un truc à retenir », mais : « ah, ça, ça ressemble à ce qu’on a vu la semaine dernière ».
Et c’est là que la mémorisation commence à faire son travail.
Ensuite, chaque catégorie mérite un exemple frappant. Pas un exemple générique et tiède. Un vrai exemple, concret, parlant, un de ceux qu’on n’oublie pas. Parce qu’un bon exemple, c’est un point d’ancrage.
C’est une image mentale.
C’est un raccourci vers la compréhension.
C’est surtout ce qui permet à l’élève de connecter immédiatement l’idée nouvelle à une expérience, une image, une situation déjà rencontrée. Le cerveau adore faire des ponts [7]. Il retient mieux quand il peut dire : « c’est comme… » ou « ça me fait penser à… ». L’exemple est donc bien plus qu’un support : c’est un connecteur.
Ajoutez à cela des cartes mentales, des schémas, des arbres logiques. Le cerveau ne retient pas une suite de données empilées. I
ll retient des structures.
Il aime voir les liens.
Il veut comprendre comment une chose en entraîne une autre.
La carte mentale n’est pas une décoration, c’est une traduction visuelle de la façon dont on vous propose de penser. C’est une invitation à naviguer dans le savoir, et à y revenir. Et là encore, chaque branche d’une carte, si elle est bien faite, renvoie à un savoir antérieur. Ce que vous offrez, ce n’est pas une nouvelle île flottante. C’est un continent qui se connecte au reste.
Enfin — et c’est sans doute le plus puissant — mettez les élèves en situation de tri, de regroupement, de classement.
Faites-les réfléchir avec leurs mains, avec leurs yeux, avec leur logique. Donnez-leur des éléments à comparer, à distinguer, à hiérarchiser.
Qu’ils classent des figures selon leurs propriétés, des mots selon leur origine, des arguments selon leur force. Là encore, ce n’est pas un jeu. C’est une manière de forcer le cerveau à mobiliser ce qu’il connaît déjà pour faire face à une situation nouvelle.
C’est là que le transfert se construit. C’est là que le savoir se consolide. Et c’est là, surtout, que les élèves commencent à se sentir intelligents, parce qu’ils comprennent qu’ils savent déjà… quelque chose.
En réalité, c’est toujours ça qu’on devrait viser : non pas bourrer une tête vide, mais connecter une idée fraîche à un terrain déjà fertile.
Et pour que ce terrain le soit, il faut l’avoir préparé : avec des catégories, des exemples solides, des cartes mentales, et des exercices de structuration active.
C’est ça, enseigner.
Pas tout dire.
Mais tout relier.
Et montrer comment penser devient possible quand on sait où poser les pieds.
✏️ En résumé
Le cerveau humain a besoin de catégories.
C’est vital, pas accessoire.
Refuser de catégoriser, c’est laisser place au flou, au jugement, à l’échec.
Et vous savez quoi ?
Mettre dans des cases, ce n’est pas un crime.
C’est un acte pédagogique structurant.
Ce qui compte, ce n’est pas la case.
C’est ce qu’on en fait ensuite.
Et la liberté de la redessiner.
Sources et références
[1] Simplifying our world – Mice master complex thinking with a remarkable capacity for abstraction https://www.mpg.de/16747094/0416-psy-simplifying-our-world-155111-x
Reinert, S., Goltstein, P. M., Hübener, M. & Bonhoeffer, T. (2021). Mouse prefrontal cortex represents learned rules for categorization. – https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33883745/
[2] Szabolcs Kéri, « The cognitive neuroscience of category learning », Brain Research Reviews, Vol. 43(1), p. 85‑109, septembre 2003. – https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14499464/
Cette revue aborde comment l’apprentissage des catégories mobilise des processus tels que la perception, l’attention, la mémoire et la prise de décision, ainsi que l’implication de zones cérébrales comme le cortex préfrontal, les ganglions de la base et l’hippocampe.
[3] « Common and distinct neural substrates of rule- and similarity-based category learning » https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0010027725000836
[4] « Driving factors of auditory category learning success » https://arxiv.org/abs/2506.01508 Ces résultats sont confirmés par une méta-analyse récente (2025, arXiv) compilant plus de 4 500 sujets, qui souligne que l’apprentissage de catégories auditives mobilise en priorité les réseaux fronto‑temporal‑pariétaux, notamment lors d’activités de langage et de reconnaissance sensorielle
[5] « Category-Biased Neural Representations Form Spontaneously during Learning That Emphasizes Memory for Specific Instances » – https://www.jneurosci.org/content/42/5/865
[6] « Interactions between the medial prefrontal cortex, dorsomedial striatum, and dorsal hippocampus that support rat category learning » https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2025.04.21.649785v1.full
[7] « How to optimize knowledge construction in the brain » https://www.nature.com/articles/s41539-020-0064-y
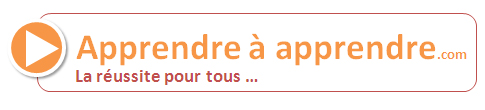
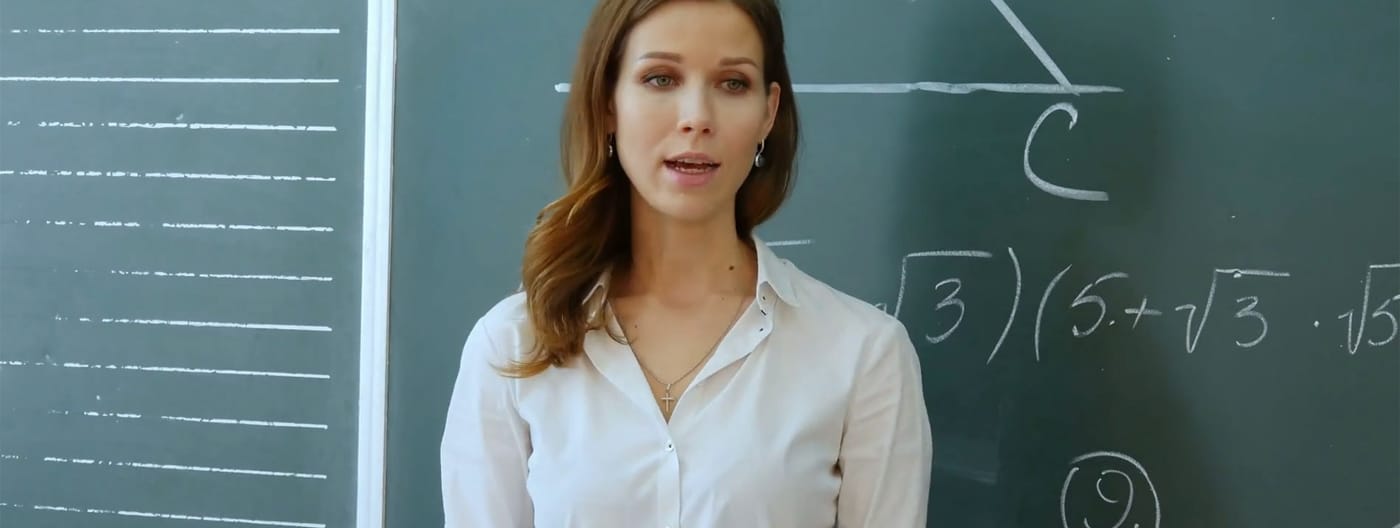
Très intéressant ! Merci, je comprends la notion d’ancrage.
Bonjour,
Merci pour votre message.
Bonne journée
Jean-François
Bravo c’est très intéressant.
Merci! pour vos encouragements.
Bonne journée
Jean-François
Un éclairage nouveau, sur les differentes perceptions de l’apprentissage des élèves devant de nouvelles connaissances.
Très intéressant !!
Bonjour,
merci pour votre message et vos encouragements.
Bonne journée
Jean-François